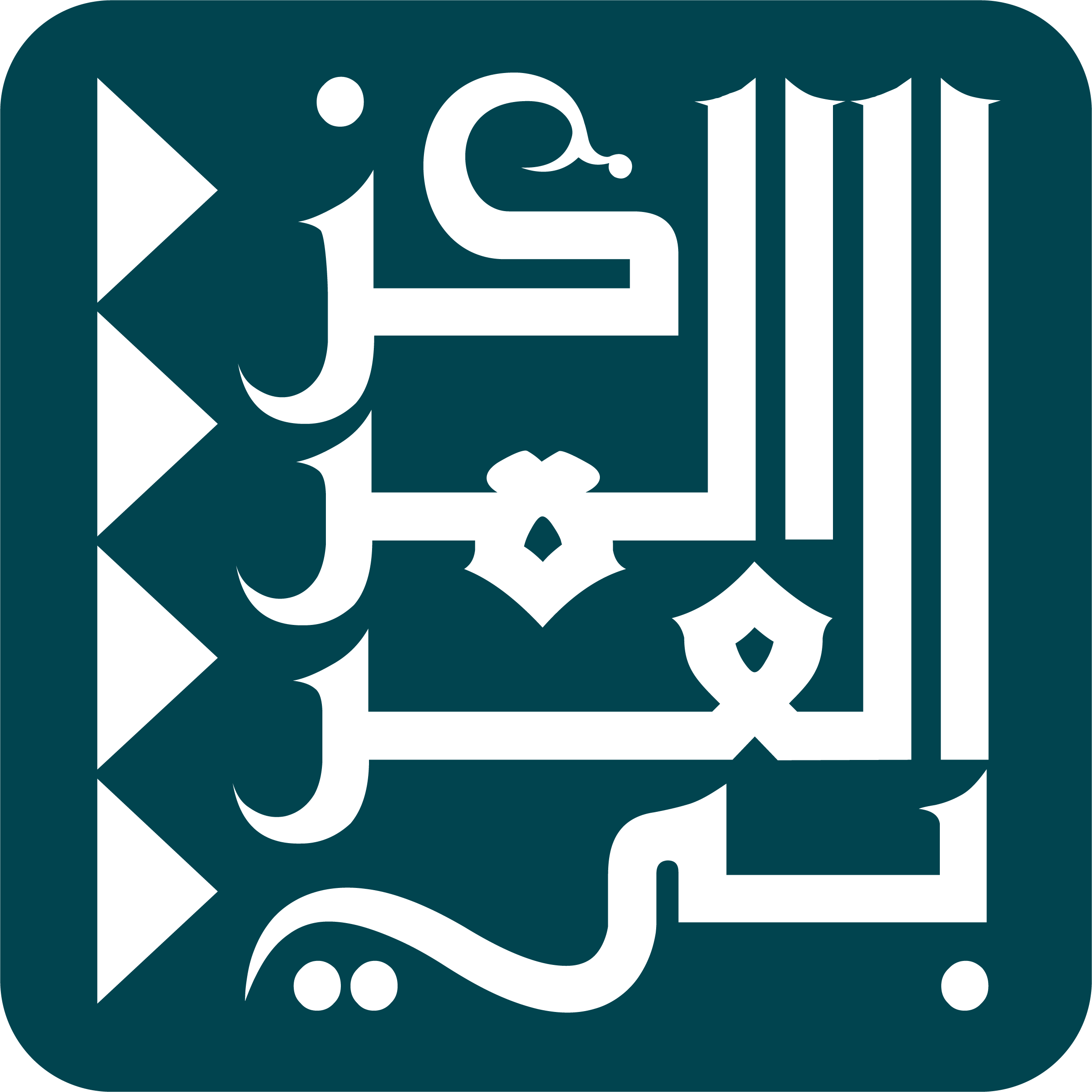Cette journée d’étude est organisée le lundi 17 mars 2025 par le CAREP Paris en partenariat avec le Département d’études arabes de l’Inalco.
- Comité d’organisation : Isabel Ruck, CAREP Paris, et Mathias Hoorelbeke, Inalco,
- Lieu de l’événement : Auditorium de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
- Horaires : 10h00 – 17h30 (suivi d’une projection-débat du film documentaire « Mauvaise langue » de 18h à 20h)
- Suivre cet événement sur Youtube (uniquement panel 1 et la table-ronde) : https://www.youtube.com/live/uHUN3oUb5HY?si=-8LWNjNs8Kb7yNcV
Argumentaire
L’enseignement de l’arabe en France s’inscrit dans un contexte socio-politique complexe, marqué par des débats sur l’intégration, la diversité culturelle et la politique linguistique. Bien que l’arabe soit la deuxième langue la plus parlée dans le pays, elle demeure enveloppée de controverses et de défis significatifs. Cette journée d’étude vise à évaluer l’état actuel de l’enseignement de l’arabe, à examiner les représentations publiques de ses locuteurs et à discuter des pistes de réflexion pour une meilleure reconnaissance dans le système éducatif français.
La recherche sur l’enseignement de l’arabe en France est abondante mais fragmentée. Elle aborde principalement les aspects migratoires et religieux, souvent sous l’angle de l’intégration sociale et du bilinguisme. Des études comme celles de Yahya Cheikh (2010) et de Chantal Tetreault (2021) ont exploré les politiques éducatives et les attitudes institutionnelles envers l’arabe, soulignant une tension entre les besoins de la population arabophone et les politiques linguistiques nationales. Les travaux de Alexandrine Barontini (2013) examinent les représentations sociolinguistiques, les pratiques langagières, et les processus de transmission de l’arabe maghrébin en France. Elle souligne notamment l’importance des contextes sociaux et politiques qui façonnent les dynamiques de la transmission linguistiques et culturelles, mettant en lumière les transformations profondes de la société française et les débats actuels autour de l’héritage colonial et de la mémoire des immigrations. Par ailleurs, des travaux de jeunes chercheurs comme Alexis Ogor (2023) ont mis en lumière la diversité des profils des apprenants d’arabe, et leurs trajectoires socio-professionnelles.
Malgré ces recherches, plusieurs zones d’ombre demeurent. Premièrement, il existe un manque de données empiriques sur les résultats à long terme de l’enseignement de l’arabe sur l’intégration sociale et professionnelle des arabophones en France. Deuxièmement, la dimension de la perception publique de l’arabe, souvent associée à des questions de sécurité nationale et de communautarisme, nécessite une analyse plus nuancée et détaillée. Troisièmement, l’impact des médias et du discours politique sur l’enseignement de l’arabe et ses locuteurs est encore insuffisamment étudié.
Cette journée d’étude vise à combler ces lacunes en réunissant des experts de divers horizons pour un dialogue interdisciplinaire. Elle cherchera à mieux comprendre comment les politiques éducatives peuvent être alignées avec les réalités multiculturelles de la France contemporaine, et comment l’arabe peut être promu non seulement comme une langue de l’héritage, mais aussi comme une ressource stratégique pour le pays. En abordant ces questions, nous espérons contribuer à une réflexion plus équilibrée et pragmatique sur l’enseignement de l’arabe en France, en éclairant à la fois les pratiques actuelles et les opportunités futures.
Références bibliographiques sélectionnées
BARONTINI, A. (2013). Locuteurs de l’arabe maghrébin–langue de France : Une analyse sociolinguistique des représentations, des pratiques langagières et du processus de transmission, Dissertation Linguistique, Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Inalco Paris.
BOURDIEU, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
CAUBET, D. (2008). Immigrant languages and languages of France. In M. Barni and G. Extra, (Eds.), Mapping linguistic diversity in multicultural contexts, Walter de Gruyter, pp. 163-193.
CHEIKH, Y. (2010). L’enseignement de l’arabe en France. Les voies de transmission, Langues et migrations, n°1288, pp.92-103. DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.870
HELLER, M. (2007). Bilingualism as ideology and practice. In M. Heller (Ed.), Bilingualism: A social approach. Palgrave Macmillan, pp.1-22.
YAFI, N. (2023). Plaidoyer pour la langue arabe. Paris, Éditions Libertalia.
MESSAOUDI, A. (2015). Les arabisants et la France coloniale. Savants, conseillers, médiateurs (1780-1930). Paris, ENS éditions.
TETREAULT, C. (2021). What is Arabic Good For?: Future Directions and Current Challenges of Arabic Language Educational Reform in France, Journal of Belonging, Identity, Language, and Diversity (J-BILD), Special Issue: Boundaries and Belonging: Language, Diaspora, and Motherland, • Vol. 5(1) • 60-82. URL: https://bild-lida.ca/journal/wp-content/uploads/2021/04/J-BILD_5-1_Tetreault.pdf
Programme
10h00 I Accueil des participants
10h30 I Introduction
- Mathias Hoorelbeke, Directeur du Département d’études arabes à l’Inalco
- Salam Kawakibi, Directeur du CAREP Paris
11h-12h30 I Panel 1 : Arabophones et arabisants en France : réalités et représentations
Sous la modération d’Isabel Ruck, CAREP Paris
Le panel vise à examiner les réalités et les perceptions des arabophones et de ceux ayant appris l’arabe en France. Si les arabophones, principalement issus de l’immigration maghrébine et moyen-orientale, rencontrent des défis d’intégration, souvent amplifiés par des représentations médiatiques oscillant entre valorisation culturelle et stéréotypes, les arabisants suivent souvent une autre trajectoire. Les travaux de l’historien Alain Messaoudi ont permis de repérer une certaine permanence des représentations arabophiles dans les milieux savants et la haute fonction publique, intrinsèquement liés à l’objectif politique colonial de développer des élites intermédiaires permettant de ne pas perdre le contact avec la population musulmane. Qu’en est-il aujourd’hui ? La langue arabe peut-elle se libérer des relents coloniaux et postcoloniaux qu’elle charrie ?
Intervenants :
- Alain Messaoudi, Université de Nantes
- Catherine Pinon, Université Aix-Marseille
- Patrice Paoli, ancien diplomate
12h30 -14h I Pause déjeuner libre
14h-15h30 I Panel 2 : L’enseignement de l’arabe en France
Sous la modération de Mathias Hoorelbeke, Inalco
Ce panel s’intéresse à l’enseignement de l’arabe en France, généralement abordé sous les angles migratoire et religieux.Confronté à des défis tels que le manque de ressources et de professeurs qualifiés, l’enseignement de l’arabe est parfois entaché par des controverses politiques qui influencent les politiques éducatives. La façon dont le statut complexe de l’arabe et les controverses entourant son enseignement en France se manifestent aussi dans l’organisation des programmes académiques et dans les parcours sociaux des étudiants qui suivent ces formations à l’université. Et pourtant, l’apprentissage de l’arabe offre des opportunités d’intégration sociale et de dialogue interculturel, renforçant les liens des élèves avec leur patrimoine tout en ouvrant des perspectives sur une langue de grande importance internationale. Promouvoir une approche objective de l’enseignement de l’arabe pourrait aussi contribuer à la cohésion sociale en France.
Intervenants :
- Fouad Mlih, maître de conférences de langue et culture arabes. Membre titulaire du laboratoire HISCANT-MA (Histoire et Culture de l’Antiquité et du Moyen Âge) à l’Université de Lorraine
- Dounia Zebib , IA-IPR, Académie de Paris
- Alexis Ogor, Doctorant à l’Université de Limoges
15h30 – 16h I Pause café
16h-17h30 I Table-ronde : Plaidoyer pour la langue arabe
Sous la modération d’Akram Belkaïd, Le Monde Diplomatique
Ce dernier panel réunira des acteurs politiques et professionnels pour discuter de la valorisation et de la promotion de l’arabe en France. Il vise à explorer les perspectives de l’arabe non seulement en tant que langue de communication mais aussi comme outil d’intégration sociale et culturelle. Les participants débattront des défis associés à l’enseignement de l’arabe, des préjugés rencontrés par les arabophones. Ils aborderont également le rôle des médias et de la politique dans la perception de cette langue.
Intervenants :
- Nabil Wakim, Journaliste au Monde et auteur de « L’arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue en France » (Seuil, 2020)
- Nisrine Al-Zahre , Directrice du Centre de Langue et Civilisation Arabes à l’IMA
- Nada Yafi, Ancienne interprète et diplomate française dans des pays arabes
18h-20h I Projection-débat du film documentaire « Mauvaise langue »
Avec le réalisateur Jaouhar Nadi et Lamiss Azab, politiste et traductologue et Directrice du campus de Paris de Sciences Po.
Biographies des intervenants
AL ZAHRE, Nisrine
Titulaire d’un doctorat en sciences du langage de l’Université de Paris VIII, spécialisée en morphosyntaxe, elle a enseigné la linguistique, la traduction et les langues dans différentes universités et institutions entre la Syrie et la France, de 2000 à 2021. Elle est par ailleurs traductrice et cofondatrice du site Al-Jumhuriya.net. Depuis septembre 2021, elle dirige le centre de langue et de civilisation arabes à l’Institut du monde arabe.
AZAB, Lamiss
Lamiss Azab est politiste, docteure en traductologie et l’actuelle directrice du Campus de Paris de Sciences Po.
BELKAÏD, Akram
Akram Belkaïd est rédacteur en chef du mensuel Le Monde diplomatique et membre du comité de rédaction du site Orient XXI.
HOORELBEKE, Mathias
Professeur agrégé d’arabe (2006-2017), maître de conférences en langue et littérature arabes (depuis 2017), directeur du département des études arabes à l’Inalco (2022-2025).
KAWAKIBI, Salam
Salam Kawakibi est chercheur en sciences politiques et le directeur du Centre arabe de recherches et d’études politiques (CAREP). Il a été le directeur de l’Institut français du Proche-Orient à Alep de 2000 à 2006.
MESSAOUDI, Alain
Alain Messaoudi est maître de conférences en histoire contemporaine à Nantes Université, membre du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA) et membre associé de l’IMAF. Ses travaux portent sur les échanges entre le monde arabe et l’Europe depuis le XIXe siècle, en matière de savoirs (Les arabisants et la France coloniale (1780-1930). Savants, interprètes, médiateurs, Lyon, ENS Éditions, 2015) d’imaginaires et de cultures visuelles.
MLIH, Fouad
Professeur agrégé et Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Fouad Mlih a enseigné la langue et la littérature arabes pendant plus de 10 ans à l’Université de la Sorbonne avant de rejoindre l’Université de Lorraine. Il enseigne l’arabe à l’American University of Paris depuis 2007 dans les programmes de premier et de deuxième cycles. Ses recherches actuelles portent sur la philosophie arabe et ses liens avec la connaissance du kalām (théologie) et le domaine de l’adab (littérature et sciences).
NADI, Jaouhar
Jaouhar Nadi est un journaliste et réalisateur franco-marocain, né à Paris en 1980. Titulaire d’une Maîtrise en LEA, et diplômé de l’Institut Pratique du journalisme (IPJ), il commence sa carrière à France 3. Il réalise plusieurs reportages pour l’émission l’Effet papillon (CAPA), puis intègre différentes rédactions en tant que réalisateur. Il a notamment travaillé pour les émissions de Martin Weill (Bangumi), Sur Le Front (Winter productions), Arte Regards (Together), Enquête Exclusive (Nova).
OGOR, Alexis
Alexis Ogor est doctorant en sociologie rattaché au Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (Université de Limoges) et au Centre européen de sociologie et de science politique (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Son travail de thèse porte sur les trajectoires sociales des étudiants en langue et civilisation arabe en France et vise à déterminer dans quelles conditions la langue arabe peut constituer une ressource lorsqu’elle est étudiée dans le supérieur. Dans cette optique, il réalise une enquête ethnographique dans différents établissements universitaires parallèlement à un travail statistique sur plusieurs bases de données du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
PAOLI, Patrice
Ancien diplomate et porte-parole en arabe du ministère des affaires étrangères français. Monsieur Paoli était ambassadeur au Koweït (1999-2002), aux Emirats arabes unis (2005-2008), au Liban (2012-2015) et à Cuba (2018-2022).
PINON, Catherine
Professeur agrégée d’arabe, docteur en linguistique arabe. Elle a enseigné la langue arabe à l’Université d’Aix-Marseille et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Actuellement en poste en collège et lycée professionnel, elle est chercheure associée à l’IREMAM et à l’Ifpo (Institut français du Proche-Orient). Ses travaux portent notamment sur l’épistémologie et la transmission des connaissances linguistiques et grammaticales arabes ou encore sur la didactique de l’arabe langue étrangère. Elle est co-auteur avec Frédéric Imbert d’une méthode de langue arabe parue en 2022 : “L’arabe dans tous ses états. La méthode” (Ellipses).
RUCK, Isabel
Isabel Ruck est une politiste spécialisée sur le Moyen-Orient. Elle est actuellement responsable de la recherche et de la coordination scientifique au CAREP Paris. Depuis 2012, elle est également enseignante à Sciences Po Paris. Entre 2018 et 2019, elle a occupé le poste de chargée de projet pour le programme Forccast, une initiative d’excellence en éducation innovante soutenue par le ministère français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
WAKIM, Nabil
Nabil Wakim est journaliste au Monde, et anime le podcast et la newsletter Chaleur humaine consacrée au défi climatique. Il est l’auteur de L’Arabe pour tous – pourquoi ma langue est tabou en France (Seuil), qui a inspiré le film Mauvaise Langue.
YAFI, Nada
Nada Yafi a été interprète officielle pour la langue arabe auprès du Ministère des affaires étrangères et de la Présidence française (1989-2003), diplomate après sa réussite au concours de Conseiller des affaires étrangères du Quai d’Orsay en 2003, ambassadrice de France au Koweït (2010-2014), directrice du centre de langue et de civilisation arabes de l’Institut du monde arabe (2014-2018 et 2019-2020). Elle publie en janvier 2023 « Plaidoyer pour la langue arabe » dans la collection Orient XXI chez Libertalia.
ZEBIB, Dounia
Dounia Zebib est inspectrice académique et inspectrice pédagogique régionale pour la langue arabe au sein de l’académie de Paris.