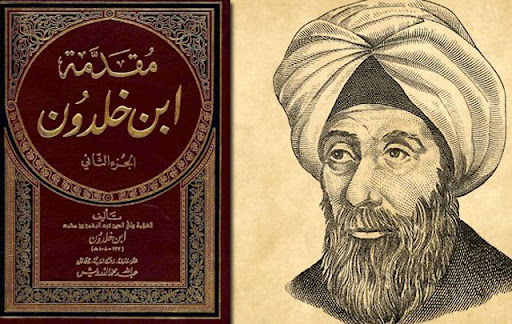Un penseur de la peste
Ibn Khaldoun, né en 1332 et mort en 1406, nous déroute aujourd’hui plus encore qu’il ne surprenait ses premiers lecteurs, et ceci pour une raison simple : nous ne vivons pas, pour le dire avec le vocabulaire actuel, le même « régime d’historicité ». Malgré nos déboires collectifs, nous gardons tous en tête une histoire « progressiste », née de la révolution industrielle et de la Révolution française, sa contemporaine, et nous restons intimement convaincus que le monde avec nous, et après nous, continuera d’aller de l’avant.
Ibn Khaldoun naît dans un monde globalement stagnant depuis des siècles, mais que vient frapper brutalement le pire désastre de l’histoire – si l’on exclut l’extermination des populations américaines par le choc microbien aux XVIe et XVIIe siècles –, à savoir la peste noire, dont les répliques meurtrières le poursuivront jusqu’à sa mort, au Caire. Il a 16 ans en 1348 quand elle atteint sa ville natale, Tunis, tue son père et les deux tiers de ses maîtres. Il voit alors jusqu’à sa mort la population du monde méditerranéen décroître d’au moins un quart. Ibn Khaldoun vieillit et décline avec l’humanité entière : des villages disparaissent, des routes se perdent, la moitié du Caire est abandonnée…
L’historien survit pourtant, et reprend naturellement le rang que les siens tenaient depuis longtemps – les Banu Khaldoun sont des nobles d’origine yéménite, établis en al-Andalus après la conquête arabe, vers 740. Comme l’expliquera sa théorie, ils y ont d’abord tenu un rôle guerrier, avant de se soumettre au pouvoir des califes omeyyades puis à celui des souverains berbères qui occupent la région entre le XIe et le XIIIe siècles.
Gabriel Martinez-Gros
Gabriel Martinez-Gros est professeur émérite d’histoire médiévale à l’université de Nanterre. Il a en outre dirigé avec Lucette Valensi l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM/EHESS). Spécialiste de l’histoire d’al-Andalus, traducteur du Collier de la Colombe, il a publié entre autres L’idéologie Omeyyade (Casa Velazquez, 1992), Identité andalouse (Actes Sud, 1997), Ibn Khaldûn et les sept vies de l’Islam (Actes Sud, 2006), avec Lucette Valensi L’Islam en dissidence (Seuil, 2004, réédité « Points Histoire » L’Islam, l’islamisme et l’Occident 2013), et Brève Histoire des empires (Seuil, 2014). Il vient de faire paraître, Ibn Khaldûn, une anthologie, Passés Composés, 2024.
Depuis de nombreuses générations, ses ancêtres sont financiers ou juristes, juges ou professeurs. En 1246, à l’approche de la reconquête chrétienne, les Banu Khaldoun, enracinés à Séville depuis cinq siècles, quittent la ville pour Tunis, où Ibn Khaldoun naît en 1332.
Au Maghreb, les élites andalouses exilées monopolisent la direction des administrations et les fonctions intellectuelles. Dès l’âge de 18 ans, Ibn Khaldoun est appelé à la cour par le souverain marocain, alors le plus puissant d’Afrique du Nord. Pendant vingt-cinq ans, il sert, dans les plus hautes charges, les souverains de Fès, de Tlemcen, de Constantine ou de Bougie… Puis brutalement, en 1375 – à 43 ans –, il se retire dans la solitude d’une petite forteresse arabe des hauts plateaux de l’Ouest algérien d’aujourd’hui, où il écrit en quelques mois l’introduction théorique, Muqaddima, de son Histoire universelle – qui fait sa gloire encore aujourd’hui. Dans le récit qu’il nous a laissé de sa vie, il décrit le tourbillon des pensées qui l’assaillent dans sa retraite et qui, dit-il, lui font tout comprendre.
Gouverner, c’est créer de la richesse
Que comprend-il donc ? D’abord qu’il est inutile de s’acharner à administrer le Maghreb, qui ne peut plus l’être. Les populations traditionnellement clairsemées de ces territoires sont tombées à cause de la peste à un niveau si bas qu’il est impossible d’acquitter l’impôt, de nourrir des villes et de soutenir l’essor d’activités de haute valeur ajoutée, dirions-nous. Il comprend donc que la santé d’un État dépend du nombre des hommes, et surtout de leur concentration, que l’autorité publique est précisément chargée de favoriser. Les sociétés agraires, qu’elles pratiquent l’agriculture ou l’élevage, ignorent la croissance économique. Ces sociétés n’épargnent pas non plus, elles consomment aussitôt la totalité de ce qu’elles produisent. Ibn Khaldoun les nomme « bédouines ». Nomades arabes ou paysans kabyles, la peste a fait retomber l’essentiel des habitants du Maghreb dans cette « bédouinité ».
Pour créer de la richesse, il faut au contraire une population capable de payer un impôt, dont on concentre le produit dans la ville capitale, où cette mobilisation des ressources attire les compétences et leur permet de s’épanouir. De nouveaux métiers et de nouveaux raffinements naissent de l’expansion de la demande et de la division du travail. Dans le monde bédouin, chaque artisan produit ses outils ; dans une société qui se développe, des menuisiers apparaissent dans les bourgs, des charpentiers dans les grandes villes, parfois des ébénistes dans les métropoles. Les gains de productivité ainsi obtenus enrichissent la ville comme les campagnes qui les nourrissent. Ils profitent à tous, et même à ceux que lèse dans un premier temps le paiement de l’impôt, qui peut apparaître alors comme un investissement dont le rendement différé est supérieur à la mise. Ce sont ces populations, nombreuses grâce à la protection qu’offre l’État, grâce à l’épargne qu’il permet au-delà de la pure subsistence, qu’Ibn Khaldoun nomme « sédentaires ».
Tout serait pour le mieux si ce processus de « sédentarisation » était volontaire ; les choses ne sont malheureusement pas si simples. L’impôt est l’héritier des razzias des premières guerres néolithiques, du tribut que le conquérant exige du conquis. Il humilie, et les peuples libres refusent de le payer. Cette résistance enraye le processus de sédentarisation, le progrès. Si la pensée d’Ibn Khaldoun semble parfois proche de celle des philosophes des Lumières, elle s’en détache ici. Pour les philosophes, dès lors que l’individu a résolu de s’associer avec ses semblables pour mieux vivre, il n’est pas d’obstacle sur le chemin de la réunion des hommes et des forces. Les communautés croissent naturellement du village à la petite ville, et du bourg à la capitale. C’est une vision erronée, nous dit Ibn Khaldoun. Les communautés naturelles, « tribales », sont fondées sur la valeur décisive de la solidarité. En l’absence d’État – que ces sociétés ignorent –, la solidarité est indispensable pour garantir la sécurité physique, la coopération dans le travail, le soutien aux veuves et aux orphelins. Or, cette solidarité spontanée, radicale, indiscutée, ne s’étend qu’à un clan restreint de quelques dizaines ou centaines d’individus. Si un heureux hasard démographique étend le groupe au-delà de ces dimensions – celles de la « tribu néolithique », disait Claude Lévi-Strauss –, il se scinde pour préserver la force des solidarités de chaque clan. Jamais la croissance démographique de la tribu, d’ailleurs rarement observée sur le temps long, n’aboutit à un rassemblement de populations qui autoriserait la ville, l’essor de l’État et de l’économie sédentaire.
Désarmer
L’État est un processus tout différent : il ne naît pas de la solidarité, mais de la coercition. Il ne peut lever l’impôt dont dépend son existence qu’en désarmant ses sujets, et c’est ce désarmement qui caractérise la sédentarisation. Il suppose la soumission des populations par la force parfois, mais le plus souvent par la pacification, la conviction, l’éducation, le respect des lois, voire l’infusion d’un peu de lâcheté dans les âmes. Selon la métaphore favorite d’Ibn Khaldoun, les sédentaires se reposent sur l’État comme des femmes et des enfants sur le chef de famille. Ils jouissent en retour des douceurs de la civilisation, du raffinement des manières, des mœurs, des objets, des pensées.
Mais en désarmant ses populations, l’État les met – et se met – en péril. Tout se passe comme si la greffe de l’État et de l’impôt, indispensables à la prospérité, exigeait l’abaissement des défenses immunitaires de la société. Nombreux, prospères mais désarmés, les sédentaires forment une oasis de richesse sans défenses, encerclée et harcelée par la convoitise des tribus bédouines environnantes. L’État n’a d’autre recours, pour protéger son troupeau productif, que de faire appel à quelques-unes de ces tribus. La civilisation sédentaire fait disparaître chez ses membres l’agressivité naturelle des sociétés primitives en les transformant en travail, en épargne et en pensée. Cette agressivité est alors sollicitée à l’extérieur du groupe pour assumer les fonctions de violence de l’État – police et armée – et s’y spécialiser, comme d’autres assument le travail du bois ou du textile.
Que la société sédentaire acquière volontairement la violence bédouine ou qu’elle cède à l’invasion des tribus rassemblées par l’appel du pillage ou d’une cause religieuse hétérodoxe que la ville a rejetée, l’essentiel tient en quelques mots : l’État est fait de la conjonction du travail d’une sédentarité productive et prospère et d’une souveraineté violente, qui défend les sédentaires comme un maître défend son troupeau. Une fois au pouvoir, les violents protègent paradoxalement l’ordre et la paix, parce que la paix favorise la prospérité, accroît le revenu de l’impôt et accroît donc la puissance et la jouissance de ceux qui règnent.
Mais le processus ne s’arrête pas là : poussés à la sédentarité par leur mainmise sur l’État, les Bédouins victorieux en touchent vite les limites. L’État qu’ils contrôlent assure la sécurité, la justice, le soutien aux pauvres, aux veuves et aux orphelins bien mieux que ne savait le faire la tribu déshéritée. Tout ce à quoi servaient les liens claniques est désormais accompli, avec une efficacité supérieure, par l’institution. Les solidarités deviennent inutiles et se nécrosent comme des organes devenus obsolètes. Il faut, dit Ibn Khaldoun, trois à quatre générations, cent à cent vingt ans, pour que rien ne reste de la cohésion initiale de la tribu dominante et qu’elle se dissolve dans le bain sédentaire des populations soumises, laissant la place libre à d’autres composantes violentes visant le sommet de l’État.
Le pouvoir est étranger
Ceux qui gouvernent viennent du monde bédouin, du monde violent. Ils sont peu nombreux, solidaires, courageux. Ceux qu’ils gouvernent sont infiniment plus nombreux, actifs, productifs, individualistes – « isolés », dit Ibn Khaldoun –, désarmés et pusillanimes. Les uns déploient la force ; les autres, le travail, l’épargne, la mémoire. Bien sûr, les Bédouins triomphent dès lors qu’ils ont réussi à concentrer un niveau critique de violence. Un faible pourcentage des populations sédentaires suffit : de 1 à 5 %, c’est ce que pesaient les Macédoniens d’Alexandre face à l’empire perse, les Germains qui envahirent l’empire romain au Ve siècle, les Arabes qui conquirent l’Iran et la Méditerranée orientale au VIIe siècle ou les Mongols qui submergèrent la Chine et l’est du monde islamique au XIIIe siècle.
Par définition donc, les empires sont fondés et gouvernés par des peuples étrangers à l’immense majorité des populations sédentaires. Le pouvoir, dans ses origines et dans son principe, ne parle pas la langue de ses sujets. Il est mongol ou mandchou en Chine ; illyrien ou germanique dans les derniers siècles de l’empire romain ; arabe et musulman dans un Orient encore chrétien aux débuts de l’Islam, puis turc quand la langue arabe et la religion musulmane sont devenues majoritaires après les XIIe et XIIIe siècles. Médecin des empereurs musulmans moghols de l’Inde au XVIIe siècle, François Bernier décrit la caste dominante des Moghols – à peine 200 000 à 300 000 administrateurs et soldats turcs, persans ou afghans pour 150 millions d’Indiens – comme « étrangers, musulmans et blancs de peau ». « Étrangers » aurait suffi. Les Moghols sont musulmans parce que les Indiens ne le sont pas et blancs de peau parce que les Indiens ne le sont pas. Bernier retrouve sans le savoir la théorie d’Ibn Khaldoun : le pouvoir est bédouin, la société des sujets est sédentaire.
Mais le courage s’érode au contact de la sédentarité. Pour Ibn Khaldoun, l’histoire est une entropie : elle se résume à la dissolution et à la disparition de l’identité dominante bédouine dans le magma sédentaire, en trois ou quatre générations. Les arrière-petits-enfants des conquérants ont adopté les mœurs de leurs sujets, exaltent la mémoire de leurs ancêtres guerriers dans de longs poèmes, exhibent chevaux de prix et armes brillantes mais ne savent pas se battre, faute de courage et de solidarités.
Et l’Occident ?
Pourquoi ce système, qui a sans doute gouverné la majorité des populations les plus denses et les plus productives du monde pendant deux mille ans, nous paraît-il si étrange ? Parce que l’Occident l’a ignoré depuis la chute de l’empire romain. L’impôt étatique y a disparu pendant près de huit siècles, jusqu’à la guerre de Cent Ans. La société s’y est « déconcentrée » et s’est ruralisée autour des châteaux et des monastères. À partir du XIVe siècle cependant, avec les débuts de la construction de l’État moderne, avec l’alourdissement considérable de l’impôt aux XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier en France, le chemin que prend l’Occident se conforme à la théorie d’Ibn Khaldoun. Les capitales gonflent, les armées se professionnalisent, les mercenaires étrangers affluent. Mais l’Occident fut sauvé par son inventivité productive : à partir de la fin du XVIIIe siècle, la « révolution industrielle » – en réalité le plus grand bouleversement scientifique, technique, agricole, sanitaire et médical de l’histoire humaine – parvient à créer de la richesse sans avoir recours à l’impôt. Le désarmement des peuples n’est alors plus nécessaire ; au contraire, l’accroissement de la richesse et l’armement des peuples, avec l’essor des États-nations, vont de pair. La liberté et la prospérité s’accordent enfin. Ibn Khaldoun aurait jugé la chose impossible…
Nous n’avons plus clairement conscience de ce qui s’est alors joué : la Déclaration d’indépendance des États-Unis et la Révolution française, qui toutes deux proclamaient la liberté et visaient la démocratie, purent le faire parce que le monde était entraîné dans un mouvement de progrès démographique, économique et matériel qui dispensait l’État d’exercer une nécessaire tyrannie sur ses sujets – devenus alors citoyens. « Le bonheur est une idée neuve en Europe », disait Saint-Just à la tribune de la Convention, mais il l’était grâce à la science, grâce à Isaac Newton, à Edward Jenner, à Gaspard Monge… ou à Antoine Lavoisier, que le tribunal révolutionnaire fit exécuter. Que le progrès économique nous manque, et la réalité de la démocratie nous échappera. D’ores et déjà, une croissance anémique – et par conséquent inégale dans la plupart des vieux pays développés – n’irrigue plus une large part des territoires, des « banlieues » aux « périphéries rurales ». La notion même de progrès est aujourd’hui remise en cause, à l’heure où il est pourtant sans doute plus nécessaire que jamais. Souhaitons d’avoir encore le pouvoir de faire mentir l’une des plus puissantes théories de l’histoire et de la vie en société jamais élaborée par un esprit humain…