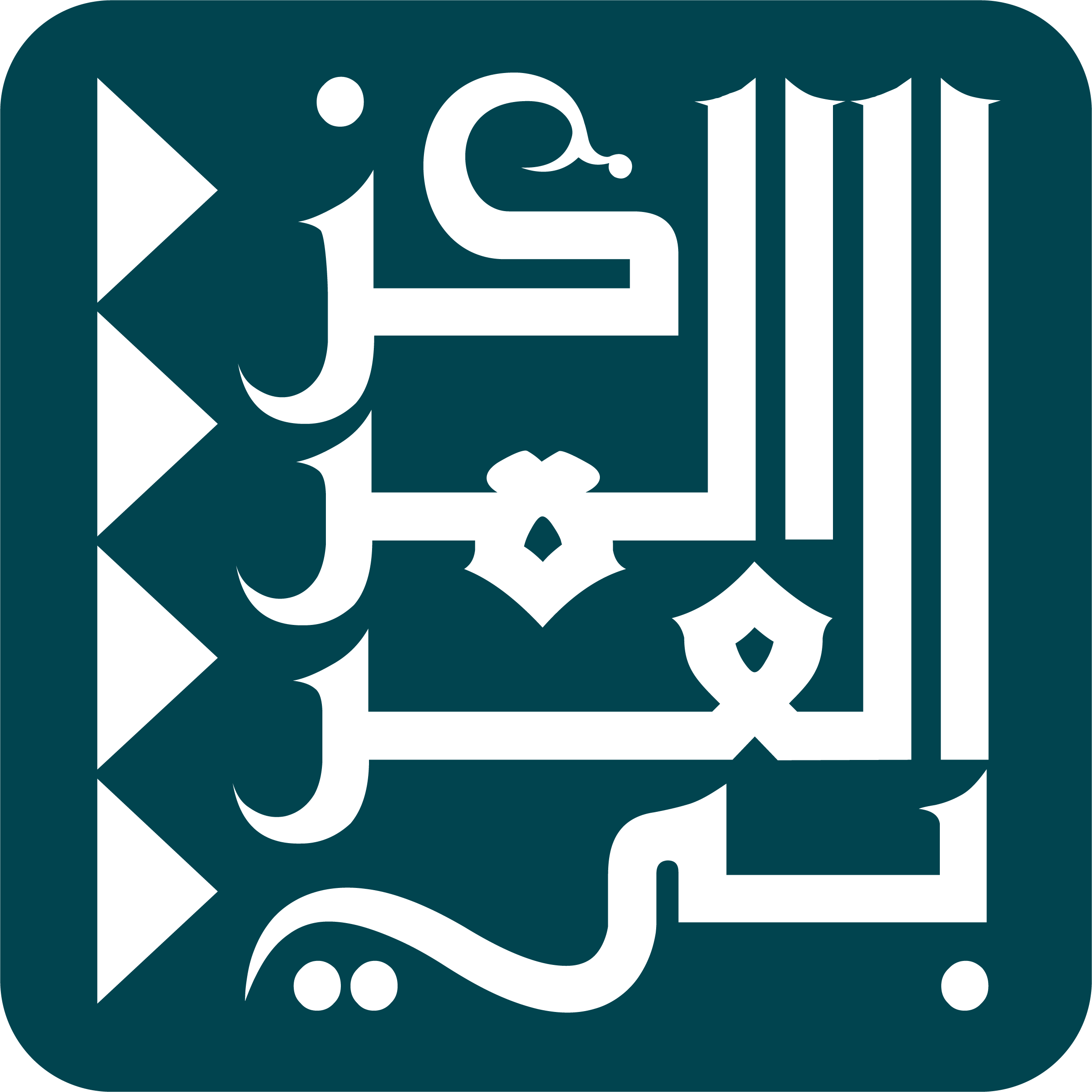Cet article est le fruit d’un séjour en Syrie de novembre 2024 à février 2025, au plus près des événements, y compris lors de la chute du régime. Rédigé sur place, il s’appuie sur des observations directes et des témoignages recueillis au cœur du pays.
Alors que la poussière retombe sur Damas, il est temps de prendre un léger recul et de tenter l’analyse des mécanismes de la victoire des rebelles sur al-Assad et celle de la nature du pouvoir qui se met en place. La chute du régime ne peut être réduite à un simple effet collatéral des guerres à Gaza et en Ukraine, ni au génie stratégique d’un seul homme, Abou Mohammed al-Joulani, de son vrai nom Ahmed al-Charaa[1].
L’opération militaire lancée le 27 novembre 2024 par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) n’a été, en réalité, que le coup décisif porté à un régime déjà affaibli politiquement, moralement et économiquement par treize années de guerre révolutionnaire. Cette victoire n’est donc pas uniquement celle d’HTC. Elle n’a été possible que par une évolution profonde des discours et des pratiques du mouvement – transformation qui n’est en réalité pas due à une évolution idéologique de l’organisation mais plutôt à des concessions faites par pragmatisme à la société et aux milieux révolutionnaires dans leur diversité.
Au-delà du triomphe d’HTC, cette victoire est avant tout une victoire syrienne, à plusieurs titres. D’abord, elle a été obtenue sans le soutien d’acteurs extérieurs, allant même à l’encontre d’un consensus international favorisant au mieux un statu quo, au pire une normalisation avec al-Assad.
C’est une victoire syrienne également parce qu’HTC n’a pas fait tomber le régime seul. Ses combattants, certes à l’initiative de l’assaut, ne représentaient pas la moitié des participants à la bataille de décembre. De nombreux groupes de l’Armée syrienne libre (ASL) ont repris les armes, et ce sont les anciens rebelles du Sud ainsi que les factions druzes qui sont entrées dans Damas en premier. Victoire syrienne encore parce que, pour l’emporter, HTC a dû travailler à la construction d’un nouveau consensus qui se traduit dans le discours et en partie dans les actes.
L’organisation, qui a rompu avec le djihadisme international depuis plusieurs années, va encore plus loin pendant la bataille en adoptant un discours et une symbolique nationale et non confessionnelle, dominante au début de la révolution. En ce sens, si c’est bien HTC qui a pris le pouvoir, cette victoire est aussi celle de la ligne politique authentique du soulèvement de mars 2011, à laquelle HTC a dû se plier, probablement à contrecœur.
C’est le prix que les anciens djihadistes ont eu à payer pour sortir de leur enclave sunnite d’Idlib, vouée à n’être qu’un mini-émirat islamique en sursis. Alors qu’on les croyait défaits, les révolutionnaires de 2011 ont donc (partiellement) réussi à imposer leur ligne politique aux nouveaux maîtres de Damas. Le drapeau révolutionnaire, longtemps interdit à Idlib, s’est imposé comme unique symbole du nouvel État. Finalement, peu importe si le ralliement d’HTC est sincère, il ne s’agira pas ici de se lancer dans des spéculations sur une prétendue taqîya du nouveau pouvoir, la vraie question est de savoir si cette ligne politique va tenir dans le temps.
Pour mieux comprendre la situation, il s’agit moins d’analyser l’évolution doctrinale de l’organisation et de son leader que de saisir comment les rapports de forces au sein du mouvement révolutionnaire et de la société syrienne ont, à différentes étapes de la guerre civile, contribué à cette transformation.
De quoi le pragmatisme d’HTC est-il le nom ?
Depuis la chute du régime d’al-Assad, de nombreux analystes spéculent sur la nature politique d’HTC et sur la personnalité de son chef, rebaptisé Ahmed al-Charaa depuis son installation au palais présidentiel. Alors qu’une partie de la bourgeoisie syrienne se rassure en apprenant qu’il est issu d’une bonne famille de tradition politique nassérienne des quartiers aisés de Damas – comme si c’était un gage de quoi que ce soit –, d’autres s’inquiètent de son parcours politique et militaire dans la résistance djihadiste irakienne à l’occupation américaine, puis comme chef de la branche syrienne d’al-Qaïda.
Pourtant, pour comprendre l’évolution de Jabhat al-Nosra et d’HTC au cours du conflit syrien, on doit surtout faire le constat que cette organisation est avant tout une organisation qui a toujours fait preuve de pragmatisme stratégique, et que son alignement politique dépend moins d’évolutions idéologiques et doctrinales que d’une adaptation aux contraintes de l’environnement dans lequel elle évolue[2].
Ce qui importe donc, ce sont les pressions extérieures aux mouvements, qui ont, depuis le début du conflit, déterminé sa trajectoire. La notion de pragmatisme en politique est trop souvent confondue avec la modération, comme si dans tout contexte la capacité à faire des compromis et à renier son idéologie était l’action politique la plus sage.
Si l’on revient sur la trajectoire du mouvement que dirigeait al-Joulani pendant la guerre civile syrienne, on se rend compte bien au contraire que successivement Jabhat al-Nosra (2012-2016), puis Jabhat Fatah al-Cham (2016-2017) et enfin HTC (2017-2025) ont su habilement naviguer dans l’environnement hostile et concurrentiel de la rébellion syrienne, survivre et enfin s’imposer, d’abord face aux factions concurrentes puis face au régime.
On peut ainsi distinguer deux périodes pendant le conflit – et nous entrons très certainement aujourd’hui dans une troisième. On peut qualifier la première (2012-2017) de « djihadisme d’avant-garde » et la seconde (2017-2024) de « gouvernement révolutionnaire ». Le passage de l’une à l’autre se fait de manière progressive entre 2016 et 2020, l’année 2017 ne constituant pas une rupture en soi.
Les différents choix stratégiques démontrent une capacité de compréhension du contexte et des rapports de force, amenant l’organisation à faire des choix par pragmatisme. Ces choix l’amènent à évoluer d’un côté vers une surenchère islamiste et militariste d’abord, parce que le contexte l’exige, et d’un autre côté vers une ouverture sur la société et sur le reste du mouvement révolutionnaire.
Revenons sur la première période, au cours de laquelle la radicalité pragmatique de Jabhat al-Nosra se caractérisait par deux éléments essentiels : se distinguer des autres factions rebelles par le refus de négocier une désescalade avec le régime et une surenchère idéologique djihadiste.
Encore une fois, c’est le contexte et les rapports de forces externes à l’organisation qui nous permettent de comprendre ces choix. L’intransigeance du groupe dans le refus des négociations avec le régime et le maintien d’un ligne militariste apparaît aujourd’hui comme étant un choix raisonnable face à un régime qui n’a respecté aucun de ses engagements et a détruit une à une les poches rebelles avec lesquelles il négociait[3].
Alors que les États qui prétendaient soutenir la rébellion n’ont eu de cesse de pousser les factions dites « modérées » à des négociations vouées à l’échec, Jabhat al-Nosra s’impose comme le détenteur du monopole d’une position perçue comme authentiquement révolutionnaire, celle prônant la chute totale du régime[4]. Dans ce contexte, la position la plus pragmatique semble donc être la plus radicale.
Sur le plan idéologique, les années 2012-2017 sont également marquées par une surenchère islamiste qui frappe l’ensemble de la rébellion[5] – une dynamique qui s’explique en grande partie par la confessionnalisation du conflit, à la fois du côté du régime et de la rébellion, avec l’intervention de groupes extérieurs – Hezbollah, Iran, djihadistes étrangers –, et surtout à partir de 2013-2014, avec la concurrence imposée par l’État islamique (EI) aux autres factions.
La montée en puissance de l’EI pousse les acteurs islamistes de la rébellion dans une surenchère idéologique nécessaire, afin de limiter l’hémorragie de combattants et de financements vers une organisation qui enchaîne les victoires. Ici encore, c’est le contexte qui détermine les choix stratégiques d’HTC et qui pousse l’organisation vers une radicalisation de ses positions, l’affirmation de ses liens avec al-Qaïda ainsi que l’incorporation à haut niveau de cadres du djihad international. Dans ce contexte, pendant la période 2014-2016, Jabhat al-Nosra intensifie les liquidations de groupes de l’ASL dans le nord du pays, en particulier ceux des factions non islamistes.
À partir de 2016-2018, et de manière encore plus nette à partir de 2020, on entre dans une tout autre phase. Le contexte, qui déterminait jusque-là le positionnement de l’organisation, change radicalement et on observe alors une évolution significative dans le discours et les pratiques. Tout d’abord, entre 2016 et 2018, le régime organise l’évacuation des zones rebelles assiégées à Alep, Damas, Homs et Deraa, puis en 2020 le déplacement des populations du sud d’Idlib. Dans toutes ces zones, la présence de mouvements djihadistes était bien plus faible que dans le Nord.
L’arrivée massive à Idlib d’une population fortement politisée et ancrée dans le mouvement révolutionnaire tout en étant pour la plupart éloignée de toute idéologie djihadiste change la donne pour HTC, qui au même moment installe son « gouvernement de Salut » pour administrer les zones sous son contrôle. Cette période coïncide également avec la défaite de l’EI, qui perd Raqqa en 2017 et son dernier bastion à Baghouz en 2019, mais qui est surtout décrédibilisé politiquement.
HTC subit désormais moins la pression des milieux djihadistes, largement affaiblis, que celle d’une population désormais sous son administration directe, et dont la composition a significativement évolué avec l’arrivée en masse de révolutionnaires non djihadistes, qui finiront par lui imposer une ligne politique loin de son idéologie initiale. Enfin, un autre facteur essentiel dans le processus d’évolution de HTC est le cessez-le-feu de 2020 sous garantie russo-turque.
Après une importante offensive du régime pendant l’hiver 2019-2020 – qui réduit significativement la poche rebelle tenue par HTC –, ce cessez-le-feu est signé et, pour une fois, relativement respecté par le régime. HTC autorise des militaires russes et turques à patrouiller sur le territoire qu’il contrôle, proche de la ligne de front afin d’assurer le respect de l’accord, ce qui permet une certaine stabilité pendant presque cinq années.
Cet accord s’est fait au prix d’un renoncement important qui consistait pour l’organisation anciennement affiliée à al-Qaïda de devoir escorter des patrouilles turque et russe, deux pays considérés comme des ennemis par les milieux djihadistes. Cela ne manquera pas d’alimenter l’opposition des éléments les plus radicaux, comme ceux restés loyaux à al-Qaïda, qui tenteront à plusieurs reprises de briser ce cessez-le-feu. Ces dissidents ont été efficacement purgés et réprimés par HTC. Ainsi, on remarque que certains choix faits par pur pragmatisme (cessez-le-feu, rupture avec al-Qaïda, main tendue vers les minorités) finissent par avoir un vrai effet de transformation structurelle de l’organisation par la simple exclusion ou la liquidation des éléments les plus radicaux qui s’opposent à ces concessions.
Cette transformation, qui devient nette à partir de 2020, se traduit en termes d’administration des territoires par la généralisation progressive du drapeau à trois étoiles de la révolution, une tolérance accrue d’une société civile autonome et de contre-pouvoirs. Le mode de gouvernement d’HTC à Idlib reste autoritaire et centralisé, loin des expérimentations d’auto-organisation des conseils civils du début de la révolution, mais l’attitude des autorités s’ouvre au dialogue avec la société et fait des concessions.
Des manifestations et des grèves ont lieu régulièrement, soit pour contester la politique d’HTC, soit pour demander l’ouverture d’un front contre le régime. Pendant les deux années qui précèdent la prise de Damas, de nombreux activistes historiquement opposés à Jabhat al-Nosra puis à HTC, dont certains ont été emprisonnés, sont désormais régulièrement consultés par les dirigeants du mouvement, et à plusieurs reprises par al-Joulani lui-même.
Enfin, un dernier élément marquant de ce tournant est l’ouverture vers les petites communautés chrétiennes et druzes d’Idlib qui avaient été réprimées et partiellement expulsées. Loin d’être une simple opération de relations publiques comme ça a souvent été présenté, un processus de restitution de terres occupées ainsi qu’un engagement sérieux de garantie de sécurité ont permis des retours progressifs de population et l’établissement de connexions avec les communautés druzes insurgées du sud ainsi qu’avec les communautés chrétiennes d’autres régions, connexions qui se prouveront cruciales au moment de la bataille de novembre-décembre 2024.
La période de gouvernement révolutionnaire (2020-2024), caractérisée par un recentrage partiel d’HTC vers la ligne révolutionnaire de 2011, a donc posé les jalons de la méthode qui sera utilisée lors l’offensive éclair de la fin 2024.
La méthode HTC pour une ultime victoire sans combat (hiver 2024)
La victoire rebelle de décembre 2024 ne peut être comprise comme une victoire strictement militaire, d’une armée sur une autre. Le régime s’est effondré de lui-même, sans combattre, et l’affaiblissement du Hezbollah et le retrait partiel des Russes ne suffisent pas à expliquer cette débâcle.
Les nombreuses bases secrètes des milices pro-iraniennes découvertes après la bataille regorgeaient d’armes et, malgré la réduction de leurs capacités militaires, les Russes ont bien tenté de re-déployer leur aviation et auraient très bien pu détruire les colonnes rebelles qui avançaient sur Damas sans armes antiaériennes. Cela aurait été d’autant plus possible si les combattants du régime étaient parvenus à résister à l’offensive et à créer une ligne de front fixe facilement ciblable depuis les airs. Cependant, comme les Russes l’ont eux-mêmes déclaré, ils ne peuvent pas sauver al-Assad si ses soldats abandonnent leurs positions[6]. Cet abandon de poste généralisé s’explique davantage par les manœuvres politiques d’HTC que par ses capacités strictement militaires.
Il est important de rappeler que l’appareil militaire syrien s’était progressivement « milicisé » pendant les dernières années de conflit, dans le sillon de la dynamique de privatisation et de déstructuration de l’appareil d’État par le régime. Désormais, les unités de l’armée régulière agissaient comme supplétifs aux milices, et non l’inverse. Ces milices, souvent communautaires et sous encadrement étranger, combattaient contre un ennemi sunnite perçu comme une menace existentielle.
Cette mobilisation des minorités avait jusque-là permis de contenir les territoires sunnites, à tel point que, même à l’apogée de leur puissance, les rebelles n’avaient jamais réussi à aller au-delà d’une ligne de front marquée de manière communautaire. Au nord du pays, cette ligne ne dépassait pas les villages chrétiens et alaouites au nord et à l’ouest de Hama. Mais lors de l’offensive de l’hiver 2024, ces mêmes milices n’ont pas combattu. Comprendre cet abandon nécessite de retracer les événements étape par étape.
La première étape de la destruction du narratif communautaire du régime s’est faite au travers de la mobilisation des Druzes à partir de l’été 2023. Rapidement, l’insurrection de Soueïda se déclare solidaire des rebelles d’Idlib et établit des voies de communication entre les deux provinces. Le discours d’une rébellion sunnite contre les minorités ne fonctionne plus et déjà le régime commence à craindre la contagion au sein de la communauté alaouite. Au même moment, la main tendue d’HTC aux Chrétiens et aux Druzes d’Idlib a permis la création de points de contact inédits, qui seront utiles pour coordonner l’avancée d’HTC.
La deuxième étape intervient lors de la première phase de la bataille, avec la conquête surprise d’Alep. HTC impose une discipline de fer à ses combattants, évitant ainsi les exactions que tout le monde attendait. Une délégation de représentants d’HTC sans armes entre dans les quartiers chrétiens d’Alep pour s’adresser à la population en leur demandant d’ouvrir leur commerce, y compris les marchés de Noël et les restaurants vendant de l’alcool.
Le tout est facilité par des contacts pré-établis discrètement avec une partie du clergé d’Alep lors des rapprochements de HTC avec les communautés chrétiennes d’Idlib. Plus significatif encore, Nobl et Zahraa, deux villages chiites proches de la ville, et anciens bastions du Hezbollah, sont pris. La population qui avait fui à pied face à l’avancée des anciens djihadistes est interceptée au sud d’Alep par une unité d’HTC qui leur garantit un retour en sécurité, leur fournissant même des véhicules. Enfin, HTC libère une centaine de cadets alaouites de l’académie militaire, capturés dans les premiers jours de la bataille. Leur retour sains et saufs dans les bastions alaouites du régime ne manquera pas de porter un coup à la propagande communautaire.
La troisième étape intervient au moment de la prise de la province de Hama, et constitue le véritable point de bascule. Les milices chrétiennes, alaouites et, dans une moindre mesure, ismaéliennes ont fui sans combattre, le plus souvent sous la pression de la population locale et des chefs communautaires qui avaient, depuis la bataille d’Alep, compris qu’HTC ne constituait finalement pas une menace, et dans certains cas avaient établi des contacts directs avec la rébellion. À l’ouest de Hama, c’est le clergé orthodoxe local qui convainc les milices communautaires et la quatrième division de se retirer, alors qu’à Salamyeh HTC avait négocié la reddition pacifique de la ville avec le conseil ismaélien ainsi qu’avec l’Aga Khan, le principal dirigeant spirituel de la communauté.
La prise par HTC de Hama – et surtout de ses campagnes alaouites et chrétiennes – sans résistance ni exactions constitue un véritable tournant dans l’offensive. À partir de ce moment, il est clair que les jours du régime sont comptés. Contrairement à son prédécesseur, Jabhat al-Nosra, HTC a pris au sérieux les craintes des minorités, a adopté un discours et une symbolique nationale et inclusive (au moins pendant la bataille) et a évité les exactions. Sans cela, il est fort possible que le régime ait réussi à mobiliser ses forces pour une ultime défense, à fixer les fronts au nord de Hama, et ait peut-être permis à l’aviation russe de se redéployer.
L’entrée coordonnée avec les chefs communautaires et l’absence d’exactions se sont doublées d’une action de rétablissement rapide de certains services publics dans les territoires nouvellement libérés, en se basant à la fois sur la réouverture de certaines administrations de l’État et le déploiement de l’appareil administratif du gouvernement du Salut d’Idlib.
Il apparaît donc évident que la transformation d’HTC et de sa stratégie politique, avant et pendant la bataille menant à la victoire de décembre 2024, a été plus déterminante que les aspects militaires. Mais, avec la prise de pouvoir, Ahmed al-Charaa et son organisation entrent dans une nouvelle phase. Il est trop tôt à ce stade pour prétendre comprendre la nature du nouveau pouvoir mis en place. Mais s’il est évident que le mouvement semble confirmer sa trajectoire d’éloignement de son passé djihadiste, il apparaît aussi clairement que ce recentrage politique se fait à travers la consolidation autoritaire d’un pouvoir dont le caractère transitoire risque de s’éterniser.
Ahmed al-Charaa à l’heure de la consolidation autoritaire du pouvoir
Ahmed al-Charaa se trouve depuis le 8 décembre 2024 dans une situation paradoxale, où son autorité semble à la fois incontestée tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, mais est en même temps dans une position particulièrement fragile, au centre d’un environnement politique extrêmement fragmenté et polarisé.
Il se maintient au pouvoir grâce à une victoire dont il se croit le seul architecte, selon la formule souvent portée par ses partisans, « celui qui libère décide » (min iharer iqarer), oubliant presque que cette victoire n’a été possible qu’au prix d’importantes concessions ayant permis de rassembler ses alliés et de rassurer ses ennemis.
De plus, le pays reste sous l’influence de nombreuses factions, dont certaines ont participé à la libération du pays et qui ne manquent pas de poser leurs conditions avant d’accepter un désarmement et une dissolution de leur structure. Al-Charaa avance donc sur une ligne de crête, entre ceux qui s’opposent à une domination islamiste, exclusivement sunnite et autoritaire sur l’État, et ceux qui au contraire se sentent trahis par les revirements politiques du mouvement et la déviation de la ligne islamiste.
Par ailleurs, si les exactions auxquelles beaucoup s’attendaient ont largement été évitées pendant la bataille jusqu’au 8 décembre, celles-ci apparaissent désormais de manière inquiétante dans les régions alaouites de la côte et de Homs. Des factions, agissant souvent de manière autonome et parfois composées de combattants étrangers, prennent en main de manière chaotique les purges et le désarmement d’anciens membres du régime, le tout en l’absence de plan de justice transitionnelle.
Si le nouveau pouvoir a rapidement cédé face aux pressions sur certains sujets hautement symboliques – comme le retrait du drapeau de la chahada islamique des représentations officielles et les changements annoncés des programmes scolaires –, il ne recule pas sur d’autres particulièrement importants – comme le maintien d’un ministre de la Justice ayant pratiqué des exécutions publiques et des peines corporelles pendant le conflit ou encore les nominations de combattants étrangers à des postes d’officiers de la nouvelle armée.
À cela s’ajoute la pression des milieux islamistes qui, se sentant trahis par l’évolution idéologique de HTC, souhaitent accélérer l’islamisation de l’État et de la société ainsi que l’application de la charia. De toute évidence, plus Ahmed al-Charaa multiplie les concessions et poursuit son recentrage politique, plus l’espace politique de ses adversaires islamistes s’élargit. Depuis le 8 décembre, il doit faire face à d’intenses pressions de sa base qui exige la libération des prisonniers à Idlib. Ces revendications s’appuient sur le fait que, tandis que les prisons du reste de la Syrie ont été ouvertes et que le nouveau pouvoir a proclamé une large amnistie pour les militaires de l’ancien régime, les détenus d’Idlib, souvent issus des milieux salafistes et djihadistes et ayant milité pour l’ouverture d’un front contre Damas, restent quant à eux incarcérés.
Il est évident que les questions communautaires et les garanties de sécurité des minorités paraissent essentielles dans la toute première phase de la transition, dans un pays qui est désormais dirigé par un groupe dont l’histoire est marquée par des violences confessionnelles, et où d’importantes exactions continuent d’avoir lieu. Pourtant, à mesure que l’on avance dans le processus de transition, les questions de l’autoritarisme, de l’état de droit et de la politique économique reviennent au centre du jeu.
S’il est trop tôt pour déceler une véritable politique économique, des inquiétudes émergent quant au risque d’une accélération vers une transition néolibérale, déjà entamée par Bachar al-Assad, et dont les liens avec le déclenchement du soulèvement de 2011 ne sont plus à démontrer[7]. Il est fort probable, au regard de ce qui a été fait à Idlib, que la Syrie entre dans une phase de libéralisation économique avec une réduction du rôle du secteur public au profit du secteur privé et des ONG. Une grande incertitude demeure sur le sort des nombreux fonctionnaires qui ont été mis en congé sans solde le temps de clarifier la situation. Le démantèlement des réseaux clientélistes de l’ancien régime semble servir de prétexte à une redistribution des ressources de l’État et à un détricotage du secteur public.
Par ailleurs, les risques d’une consolidation autoritaire du pouvoir suscitent déjà de vives inquiétudes. Bien que présentée comme transitoire, la composition du nouveau gouvernement révèle la volonté manifeste d’al-Charaa de verrouiller les leviers essentiels du pouvoir en s’appuyant sur un cercle rapproché de fidèles. Les hauts dirigeants d’HTC monopolisent les postes stratégiques tandis que l’administration est soit démantelée soit encadrée par une structure parallèle fidèle à l’organisation, sur le modèle de la double structure en vigueur à Idlib.
Directement subordonnée à HTC, l’« administration des territoires libérés » (Idara al-Manateq al-Muharrara) coexistait avec l’administration plus technocratique du gouvernement du Salut. Après le 8 décembre, c’est une structure connue sous le nom d’« administration des affaires politiques » (Idara al-shuun al-siassiaya) qui permet à HTC de maintenir le contrôle sur l’appareil d’État. Si les effets concrets de cet encadrement restent difficiles à mesurer, la désignation unilatérale des dirigeants syndicaux et des instances d’encadrement professionnel, justifiée par la volonté de les épurer du parti Baath, ainsi que la perspective d’un encadrement plus strict du droit associatif, alimentent chaque jour davantage la défiance envers le pouvoir en place et la crainte d’une transition qui s’éternise avec la consolidation d’un pouvoir autoritaire.
Conclusion
L’emprise grandissante d’HTC sur l’appareil étatique syrien suscite des réticences jusque dans les cercles révolutionnaires, où certains ironisent déjà sur un « mouvement correctif » (Haraka Tas’hihiya) d’Ahmed al-Charaa, en référence au recentrage autoritaire de Hafez el-Assad en 1970 qui, tout en éliminant ses concurrents politiques, adoptait lui aussi une politique pragmatique, s’éloignant des idéaux initiaux du parti Baath.
Il est évident que le nouveau pouvoir n’est en rien comparable avec la dictature du régime précédent, dont la chute est indéniablement un progrès. Pourtant cette référence n’est pas entièrement infondée dans la mesure où, pour HTC, le recentrage politique par pragmatisme coïncide avec une prise de contrôle autoritaire, dans un premier temps d’Idlib et aujourd’hui, dans une certaine mesure, de la Syrie. Mais ce qui sera le plus déterminant, comme ça l’a été depuis le début du conflit, c’est la capacité de la société syrienne à s’auto-organiser et à constituer des contre-pouvoirs efficaces, capables de limiter les dérives autoritaires si fréquentes en période de transition et de préserver les acquis de la révolution.
Ce sont ces contre-pouvoirs qui ont (partiellement) imposé à HTC la ligne politique des révolutionnaires de 2011, poussant à une transformation en profondeur condition nécessaire à la victoire. Le retour des slogans et des symboles non confessionnels, favorisant l’unité du pays autour d’un mot d’ordre contre la dictature, peut ainsi être perçu comme un retour aux fondamentaux révolutionnaires après près d’une décennie de dérives confessionnelles.
Mais les conquêtes politiques de la ligne dite « de 2011 » restent limitées et fragiles. Les quelques tentatives de recréation de conseils locaux, modèles d’auto-organisation démocratique caractéristique du mouvement révolutionnaire syrien, restent marginales face à la mainmise d’HTC sur l’appareil d’État. De plus, si les transformations politiques d’HTC semblent acquises, une partie de l’organisation, des cadres et de la base du mouvement reste ancrée, si ce n’est dans une idéologie salafiste, au moins dans un suprémacisme sunnite certain.
De toute évidence, et comme l’ont montré les expériences difficiles des Printemps arabes, la chute du régime ne constitue qu’une étape, certes importante, mais incomplète et fragile, du processus révolutionnaire.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du CAREP Paris.
Notes :
[1] Dans cet article, nous utiliserons le nom « Abou Mohammed al-Joulani » pour la période précédant le 8 décembre – la prise de Damas – et « Ahmed al-Charaa » pour la période suivante.
[2] Jérôme Drevon et Patrick Haenni, How Global Jihad Relocalises and Where it Leads. The Case of HTS, the Former AQ Franchise in Syria, EUI Working Papers, Robert Schuman Centre for Advanced Studies – The Middle East Directions Programme, European University Institute, 2021.
[3] « La Stratégie de Jabhat al-Nusra – Jabhat Fath al-Sham face aux trêves en Syrie », Noria Research, 2 oct. 2016. URL: https://noria-research.com/fr/strategie-treves-syrie/
[4] Félix Legrand, « Foreign Backers and the Marginalization of the Free Syrian Army », Arab Reform Initiative, 13 nov. 2016. URL: https://www.arab-reform.net/publication/foreign-backers-and-the-marginalization-of-the-free-syrian-army/
[5] Ahmad Abazeid et Thomas Pierret, « Les Rebelles syriens d’Ahrar al-Sham. Ressorts contextuels et organisationnels d’une déradicalisation en temps de guerre civile », Critique internationale, 78, 2018, p. 63-84.
[7] Anand Gopal, « The Arab Thermidor », Catalyst, 2, vol. 4, été 2020.