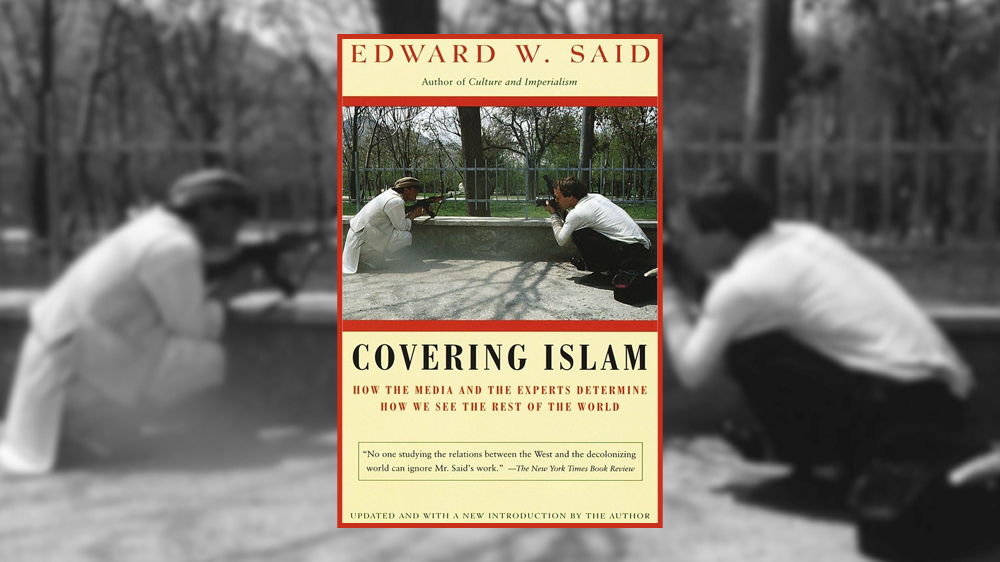Introduction
Publié en 1981, l’ouvrage Covering Islam[1] d’Edward Saïd constitue une analyse essentielle des biais persistants par lequel les médias occidentaux perçoivent et présentent l’islam. En puisant dans les théories postcoloniales, Saïd montre comment les récits médiatiques occidentaux, influencés par des experts politiques et académiques, perpétuent des stéréotypes simplistes et souvent nuisibles aux populations musulmanes.
Plus de quatre décennies plus tard, les observations de Saïd demeurent d’une actualité frappante, en particulier depuis le 11 septembre 2001, avec une montée de l’islamophobie et une focalisation incessante sur les crises dans le monde musulman. La présente analyse revisite les arguments principaux de Saïd tout en les mettant en perspective avec les développements contemporains du discours médiatique post-7-Octobre 2023, en particulier en France.
Le cœur de la théorie de Saïd
Edward Saïd constate que les médias occidentaux, souvent en collaboration avec des « experts », réduisent l’islam à une entité monolithique. Cette sur-simplification masque la diversité culturelle, ethnique et théologique de la religion musulmane. Ainsi, Saïd affirme que « l’islam n’est pas une structure monolithique et homogène[2] », même si les représentations dominantes continuent de renforcer cette idée fausse.
La couverture médiatique du monde musulman privilégie des thèmes tels que le terrorisme, l’extrémisme et les conflits sociaux, créant une image déformée de ces sociétés. Il observe que « le monde musulman est souvent représenté dans les médias uniquement lors de moments de bouleversements, laissant le public avec l’impression d’une région éternellement volatile[3] ».
Ce constat reste tristement pertinent à notre époque, où les gros titres de la presse masquent souvent le fait que les sociétés musulmanes recèlent aussi des histoires de progrès et de richesse culturelle. En France, les médias ont largement façonné le discours public sur l’islam, contribuant à l’idée d’une sorte de « crise » inhérente à la religion, comme le souligne Emmanuel Macron, lorsqu’il déclare que « L’islam est une religion en crise aujourd’hui dans le monde entier[4]. »
Dans ce contexte, il est essentiel de considérer la manière dont les discours sur l’islam peuvent s’entrelacer avec d’autres enjeux géopolitiques, notamment la question palestinienne. En effet, la tendance à amalgamer la religion avec des groupes politiques et militarisés palestiniens entraîne une vision réductrice. Emmanuel Macron, dans ses déclarations publiques, a comparé le Hamas à Daesh, deux entités qui diffèrent par leur légitimité, leur origine et leurs objectifs. Le Hamas est souvent perçu par ses partisans comme un mouvement politique palestinien, tandis que Daesh est reconnu dans le monde entier comme une organisation terroriste promouvant une idéologie extrémiste et violente.
Cette comparaison soulève des questions sur la manière dont la situation palestinienne est perçue et interprétée. Cet amalgame la réduit à une confrontation simpliste entre musulmans et juifs, occultant ainsi la vérité coloniale de cette histoire. En effaçant l’enjeu sous-jacent, à savoir la lutte pour les droits humains et l’autodétermination des Palestiniens au profit d’une dichotomie religieuse, le discours présidentiel alimente les tensions intercommunautaires en France, renforce les stéréotypes et l’islamophobie ambiante tout en minimisant les souffrances vécues par les populations concernées. Cette approche alimente les biais des médias qui, pour beaucoup d’entre eux, ont présenté le 7 octobre comme « le pogrom le plus violent de l’histoire d’Israël depuis la Shoah[5] », une affirmation erronée.
Cette idée résonne avec des études conduites par Acrimed, une association de critique des médias, concernant la couverture des événements en Palestine. Elles montrent que les médias français se concentrent souvent sur la violence contre une seule communauté sans contextualiser l’occupation israélienne ou les réalités vécues par les Palestiniens. Des chercheurs d’Acrimed observent une déshistoricisation, un temps d’antenne très limité consacré aux conditions des Palestiniens sous les bombardements (par exemple à Rafah en juin 2024), ainsi qu’une minimisation et une délégitimation de leur voix. Selon l’association, la déshumanisation des Palestiniens persiste, les médias entretiennent de fausses symétries, un discours de soutien à la propagande israélienne et la marginalisation des chercheurs compétents et des voix alternatives[6].
Le rôle des médias et des experts
Saïd note que les médias, associés aux « experts », façonnent les perceptions publiques de l’islam. Ces experts, issus d’universités, de think tanks ou d’agences gouvernementales, projettent souvent leurs propres biais, renforçant ainsi les idées reçues. Saïd ajoute que « les récits médiatiques sur l’islam sont souvent guidés par les agendas de ceux qui dominent le discours, plutôt que par un engagement authentique avec les réalités des sociétés musulmanes[7] ».
En France, ce phénomène se manifeste dans les débats publics autour de la laïcité et de l’islam. Certains politiciens et commentateurs présentent fréquemment l’islam comme étant incompatible avec les valeurs françaises, en excluant souvent les voix musulmanes elles-mêmes. Par exemple, si les lois ciblant les codes vestimentaires islamiques, comme l’interdiction du hijab dans les espaces publics, sont justifiées au nom de la laïcité, elles sont perçues par d’autres observateurs comme discriminatoires[8].
Pertinence contemporaine de l’analyse saïdienne
Depuis la publication de Covering Islam, les critiques formulées par Saïd restent pertinentes. L’ère post-11 septembre et la montée du populisme d’extrême droite dans de nombreux pays occidentaux ont exacerbé les narrations islamophobes. Les attentats terroristes en France en 2015, notamment ceux de Charlie Hebdo et du Bataclan, ont également renforcé cette perception négative de l’islam dans l’opinion publique et les médias, qui continuent d’associer de manière disproportionnée islam et violence, islam et extrémisme, souvent au détriment du contexte sociopolitique qui sous-tend ces phénomènes.
L’obsession sécuritaire sur ce sujet illustre ce biais persistant et cette « fabrique de la peur ». La couverture médiatique des discussions sur le radicalisme a souvent pour effet de marginaliser les musulmans ordinaires, contribuant ainsi à leur stigmatisation. Les déclarations d’Emmanuel Macron, qui présentent l’islam comme une religion en crise, reflètent cette tendance sans reconnaître les diverses réalités rencontrées par les sociétés musulmanes.
La polarisation du débat médiatique
Un aspect essentiel de la représentation de l’islam dans les médias français est la polarisation croissante des débats, principalement alimentée par une rhétorique qui oppose islam et Occident. La confusion entourant la laïcité dans les discussions sur le voile en est un exemple emblématique[9]. La médiatisation de certaines affaires, notamment celle des « tchadors de Creil » en 1989[10], a contribué à redéfinir ces questions sous l’angle d’un conflit culturel, où les musulmans sont davantage perçus comme des personnes en marge plutôt que comme des membres à part entière de la société française.
Cette dichotomie est souvent perpétuée par une représentation biaisée des musulmans dans les médias, où la différence culturelle est fréquemment mise en avant pour justifier des lois ou des politiques discriminatoires. Les médias exploitent des stéréotypes autour du voile et des signes religieux comme illustratifs d’une menace à l’identité nationale, souvent sans examen rigoureux des conséquences de telles représentations sur la vie quotidienne des musulmans en France.
Citations pertinentes
Dans son livre, Saïd insiste sur le fait que « le discours médiatique n’exprime que des images de crise et de conflit, ce qui a pour effet de renforcer des stéréotypes négatifs sur l’islam et les musulmans[11] ». Cette observation est corroborée par des acteurs médiatiques contemporains qui, suivant cette façon de faire, façonnent un narratif souvent hostile et déformé. L’analyste Thomas Deltombe, dans son ouvrage L’Islam imaginaire, souligne que « la construction médiatique de l’islamophobie en France, de 1975 à 2005, montre à quel point la religion musulmane a été réduite à des stéréotypes[12] ».
Ce constat est également présent dans les discours politiques récents, où sont employés régulièrement des expressions telles que « séparatisme islamique » pour stigmatiser le mouvement d’affirmation culturelle et religieuse de la communauté musulmane française. Emmanuel Macron, dans son discours du 2 octobre 2020, déclare « Le problème, c’est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, se manifeste par des écarts répétés avec les valeurs de la République, souvent à travers la constitution d’une contre-société. Ses manifestations incluent la déscolarisation des enfants et le développement de pratiques communautaires qui servent de prétexte à l’enseignement de principes non conformes aux lois de la République[13]. »
Les enjeux actuels
Aujourd’hui, le paysage médiatique est marqué par un terme nouveau, « islamo-gauchisme », qui a une puissante connotation péjorative et qui témoigne d’une continuation de la stigmatisation. Ce terme flou, utilisé pour discréditer des mouvements politiques critiques de la répression des musulmans et aussi de la répression des Palestiniens par Israël, participe du climat de méfiance et de division généralisé.
Les accusations d’« islamo-gauchisme », mêlées aux accusations d’antisémitisme, montrent comment certains médias cherchent à transformer des luttes antiracistes en menaces. Ainsi, comme le souligne Deltombe, « le retournement des valeurs de laïcité, qui était à l’origine une émancipation, se transforme aujourd’hui en une néo-laïcité punitive », où la protection des prétendues normes républicaines conduit à des politiques discriminatoires à l’égard des communautés musulmanes.
Conclusion
Covering Islam reste un texte phare d’une importance cruciale pour comprendre la dynamique complexe entre les médias, la politique et la perception publique de l’islam en Occident. Bien que certaines des critiques faites à Saïd concernant son approche généraliste ou l’absence de propositions de solutions concrètes soient valables, le cœur de son argumentation – la nécessité de représenter l’islam avec nuance et compréhension – reste fondamental dans le débat actuel.
En relisant cette œuvre à la lumière des réalités contemporaines, telles que la couverture médiatique de l’islam en France, le positionnement des autorités françaises vis-à-vis de la communauté arabo-musulmane et la couverture de la question palestinienne par les médias français, nous pouvons mesurer la persistance des préjugés et des structures de pouvoir qui influencent aujourd’hui le narratif sur les musulmans.
La demande d’une représentation plus informée, empathique et dénuée de préjugés est plus urgente que jamais, tant pour la société française que pour l’ensemble des pays occidentaux confrontés à des défis similaires en matière de diversité et au danger de la montée des discours stigmatisants autour de l’islam et des communautés musulmanes.
Une remise en question approfondie des pratiques médiatiques s’avère nécessaire, de même qu’une volonté politique authentique d’encourager un dialogue constructif intégrant l’ensemble des voix musulmanes, et pas seulement celles cooptées par le système en place.
Notes :
[1] Edward W. Saïd, Covering Islam. How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, Londres, Vintage Books, 1997.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] « “L’islam est en crise” : la phrase d’Emmanuel Macron passe mal dans le monde musulman », Radio France, 8 novembre 2020. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/revue-de-presse-internationale/l-islam-est-en-crise-la-phrase-d-emmanuel-macron-passe-mal-dans-le-monde-musulman-9586710
[5] « 7 octobre : l’enfer du supernova (3/3) », Europe 1, 3 octobre 2024. URL : https://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-lactu/7-octobre-lenfer-du-supernova-33-4270941
[6] Célia Chirol, « Bombardements israéliens à Rafah : les JT plaident le droit à l’“erreur” », Acrimed, 17 juin 2024. URL : https://www.acrimed.org/Bombardements-israeliens-a-Rafah-les-JT-plaident
[7] Edward W. Saïd, Covering Islam, op. cit.
[8] Lire par exemple le texte de Amnesty International à ce sujet, qui suggère que l’État ne doit pas interférer dans les ports de voile car cela relève de la discrimination. URL : https://www.amnesty.fr/focus/france-a-savoir-interdiction-obligation-port-du-voile
[9] Jean Baubérot, Les Sept Laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2020.
[10] En octobre 1989, l’exclusion de trois collégiennes refusant d’enlever leur voile en classe suscite la polémique.
[11] Edward W. Saïd, Covering Islam, op. cit.
[12] Thomas Deltombe, L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2007.
[13] « La République en actes : discours du président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », 2 octobre 2020. URL : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes