Par Henry Laurens
Pour commencer, afin d’éviter toute ambiguïté, il n’est pas question ici de reprendre le discours d’Edward Saïd sur l’orientalisme. Ce spécialiste d’analyse littéraire considérait la totalité de ce qui a été dit sur l’Orient, allant des pratiques artistiques aux discours des politiques, en passant par les études philologiques et historiques, comme un unique discours instrument de domination et créateur d’essences immuables rassemblées sous la dénomination orientale. En quelque sorte, il faisait un discours sur les discours. En croyant vouloir abolir l’Orient en tant qu’identité, Saïd au contraire l’a perpétué en le posant face à un Occident à son tour devenu immuable.
On s’en tiendra ici à une analyse historique prenant en compte les différentes temporalités en jeu dans l’appréhension des mondes considérés comme autres chez les Occidentaux et les Orientaux, ce dernier terme étant plus vague comme le rappelle l’expression anglaise : « the West and the Rest ».
On doit bien évidemment parler d’Orients au pluriel. Si dans ce sens actuel « Occident » apparaît à la fin du XVIIIe siècle, « Europe » est très largement dominant jusqu’au début du XXe siècle. D’ailleurs « Occident » a surtout été utilisé dans le contexte de la guerre froide de la seconde moitié du XXe siècle. Pour les musulmans, le terme « francs » est le plus couramment employé jusqu’au XIXe siècle.
L’orientalisme ici considéré comme la volonté d’acquérir un savoir sur les autres grandes sociétés de l’Ancien Monde, ou écoumène allant des îles britanniques au Japon, incluant l’Afrique méditerranéenne avec une bonne part de son littoral de l’océan Indien.
L’occidentalisme est son pendant inversé : comment les Européens ont été vus. Ces deux savoirs conduisent à l’élaboration de toute une série d’appréhensions et de comportements des mondes dits « autres ». Ces appréhensions sont ensuite traduites en termes de politiques étatiques et d’une multiplicité de pratiques sociales et culturelles.
Ces appréhensions doivent être prises dans leurs inscriptions temporelles, c’est-à-dire à la fois dans les contextes qui les produisent et dans leurs articulations dans une vision globale de l’histoire humaine.
On est ainsi conduit à distinguer trois grandes phases historiques, trois grandes configurations : une situation d’équilibre relatif, la grande divergence et la grande convergence.
L’époque des empires à la poudre à canon
L’Eurasie est une réalité historique ancienne. Depuis des millénaires, produits, idées et religions ont circulé le long d’une très mythique route de la soie. Il en a été de même pour de grandes invasions et la constitution de grands empires. Elle a été aussi la route des épidémies permettant au prix de terribles mortalités l’unification biologique de l’Ancien Monde.
La nouveauté du XVIe siècle a été ce que l’on a appelé les « grandes découvertes » dans une perspective européocentrique. Elle peut être plus proprement définie comme étant la projection maritime de l’Europe, d’abord de la part des puissances ibériques (Espagne, Portugal), puis de la part de l’Europe de l’Ouest (Angleterre, France, Pays-Bas). Se sont ainsi constitués, pour la première fois dans l’histoire, des empires ultramarins, c’est-à-dire présents sur plusieurs continents avec une rupture franche constituée par des océans, contrairement à la continuité territoriale des empires continentaux. Le schéma général est la possession de territoires dans le Nouveau Monde et de comptoirs commerciaux dans l’océan Indien.
Jusque-là, les Européens ne connaissaient vraiment que leurs voisins immédiats, les musulmans, qui dominaient la plus grande partie des rivages méditerranéens du Maroc aux Balkans. À l’époque mongole, certains voyageurs avaient pu aller jusqu’à la Chine et l’Inde, mais les connaissances restaient vagues.
Dès le milieu du XVIe siècle s’était établi un équilibre relatif constitué par les grands « empires à la poudre à canon » (Gunpowder Empires selon Marshall Hodgson) : l’empire ottoman, la Perse des Safavides, l’Inde du Grand Moghol, la Chine impériale et le Japon des Shoguns.
Ce renvoi à l’armement est essentiel. On peut considérer qu’il existe une mondialisation militaire, définie par des armes de la même nature et ayant une utilisation semblable, ce qui fait que les Européens ne se trouvent pas en situation de supériorité contrairement à ce qui se passe dans le Nouveau Monde.
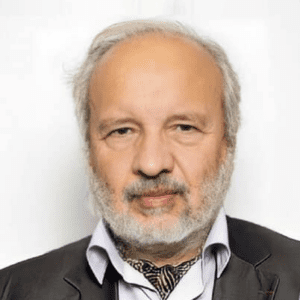
Henry Laurens
Professeur au Collège de France
Docteur d’État et agrégé d’histoire, Henry Laurens est reconnu comme l’un des grands spécialistes du Moyen-Orient. Professeur au Collège de France (titulaire de la chaire « Histoire contemporaine du monde arabe ») et à l’INALCO (Institut national des langues
et civilisations orientales), il a par ailleurs été directeur du Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain (CERMOC) à Beyrouth, puis directeur scientifique de l’Institut Français du Proche-Orient. En 2004, il a reçoit le Prix Joseph
du Theil de l’Académie des Sciences morales et politiques, ainsi que le Prix de l’amitié franco-arabe de l’Association de solidarité franco-arabe. Henry Laurens est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : La Question de Palestine, tomes I, II, III, IV et V (Fayard, 1999/2002/2007/2011/2015), L’Orient arabe à l’heure américaine (Armand Colin, 2004), Orientales, tome I, II et III (CNRS éditions, 2004), Histoire du monde arabe contemporain (Fayard, 2004), Paix et guerre au Moyen-Orient : l’Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours (Armand Colin, 2005), Deux siècles d’Orient (CNRS éditions, 2007) et Le Passé imposé (Fayard, 2022).
En revanche, ce que l’on appelle « l’échange colombien », c’est-à-dire l’adoption des produits agricoles américains venus du Nouveau Monde, s’est très rapidement étendu au monde de l’islam, voire au-delà.
Les pays asiatiques, Chine et Inde en tête, restent les premiers pays producteurs d’objets manufacturés qui constituent d’ailleurs les premières importations européennes (toiles indiennes, porcelaine de Chine… ). La première forme d’occidentalisme a d’ailleurs été la production d’objets en fonction des goûts supposés de la clientèle européenne.
En Chine, on s’est intéressé à l’astronomie nouvelle, issue des premières lunettes grossissantes permettant ainsi un renouvellement d’une science très ancienne. Tout en se définissant comme il se doit au centre du monde, les sociétés dites orientales ont aussi adopté la cartographie européenne permettant ainsi la connaissance livresque des espaces américains et européens.
En Méditerranée, les Ottomans et les Marocains cherchent évidemment à se constituer un savoir que l’on pourrait définir comme géopolitique (étendue et puissance des États européens), mais il reste avant tout un savoir d’État. Le véhicule essentiel de l’écrit est toujours le manuscrit qui est peu diffusé du fait de sa nature-même. En dépit de quelques tentatives précédentes, ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que l’on se mettra à l’imprimé.
En revanche, il existe des dizaines de milliers de convertis européens à l’islam, soit à la suite de capture soit par choix personnel. Les Européens les appellent globalement des « renégats ». Ils amènent avec eux des savoirs techniques divers et certainement une connaissance de leurs pays d’origine, mais ils s’expriment essentiellement de façon orale en utilisant les mélanges de langue de la Méditerranée constituant la « lingua franca » ou « sabir ».
Il ne reste pratiquement pas de traces écrites de cette production orale dont l’importance ne doit pas être sous-estimée. Il faut ajouter le rôle d’information et de traduction venues des communautés chrétiennes et juives en contact permanent avec les Européens. Ainsi l’espace de la diaspora arménienne va de l’Italie jusqu’à l’Inde. Enfin, il existe une présence permanente des commerçants européens, dits « Francs » dans les réseaux commerciaux du monde musulman alors que très peu de musulmans sont présents en Europe (leur présence n’est d’ailleurs pas souhaitée).
L’orientalisme comme savoir imprimé
Dès la seconde moitié du XVe siècle, le mouvement humaniste européen s’appuie sur l’imprimé pour diffuser une connaissance de première main des auteurs grecs et latins ce qui impose l’établissement critique des textes et le développement progressif d’une science des langues, la philologie.
À partir du milieu du XVIIe siècle, ces humanistes élargissent leurs connaissances en s’intéressant au patrimoine des langues dites orientales, le turc, l’arabe et le persan. En même temps, les missionnaires catholiques moissonnent un savoir croissant sur l’Inde et la Chine. La connaissance de l’histoire du monde musulman se perfectionne tandis que pour la première fois les Européens se trouvent confrontés en Inde à un monde polythéiste qu’ils assimilent à celui de l’Antiquité gréco-romaine et en Chine à une société qui apparaît régie par des sagesses qui ressemblent dangereusement à de l’athéisme.
Le but de ce que l’on appellera l’orientalisme à partir du début du XIXe siècle est d’établir une littérature universelle regroupant les sources latines et grecques, les écrits européens en langues modernes et ceux en langues orientales dont on commence la traduction. À partir de là, on élabore une histoire universelle dont l’ambition est de couvrir l’ensemble de l’Ancien Monde. On en arrive ainsi à la traduction par Galland des Mille et Une Nuits au début du XVIIIe siècle et à De l’esprit des lois de Montesquieu (1748) et L’Essai sur les mœurs de Voltaire (1756) qui font la synthèse d’un siècle de travaux d’érudition encouragés par l’État qui a financé l’achat systématique de manuscrits orientaux.
De même, la littérature de pèlerinage se transforme progressivement en littérature de voyages. Le voyageur parcourt les contrées lointaines dans la perspective même d’en tirer une publication. On n’est plus dans la perspective de manuscrits ayant quelques lecteurs, mais celle d’une audience qui pourrait s’étendre à l’ensemble de l’Europe.
Les écrits des uns et des autres pratiquent un comparatisme systématique entre ce qui se passe « chez nous » et ce qui est « chez les autres ». Cela va des actes de la vie quotidienne aux sens profonds des institutions.
En Europe de l’Ouest, l’Orient bénéficie d’une présence quasi quotidienne. Les gazettes commencent par le plus lointain, qui peut être la Chine, l’Inde ou la Perse, pour aboutir au plus proche géographiquement. Les objets orientaux, dont les provenances peuvent aller de la Chine à la Méditerranée, sont présents dans les intérieurs des milieux aisés. La porcelaine chinoise et les textiles indiens sont déjà dans le domaine de la consommation courante des classes aisées.
Le comparatisme peut bien évidemment marquer la supériorité de sa propre société, mais permet aussi de s’interroger sur ses propres institutions. Au XVIIIe siècle, l’Europe est toujours composée de sociétés d’ordre mettant en avant les aristocraties héréditaires, même s’il existe des voies de promotion au mérite.
Ce modèle va se trouver contesté par l’apologie que les pères jésuites font du modèle chinois des examens. Au milieu du XVIIIe siècle, les premiers examens écrits et oraux apparaissent en France et en Angleterre pour l’accès à ce que l’on appellerait aujourd’hui l’enseignement supérieur. Plus tard, les nouveaux corps de fonctionnaires seront progressivement recrutés par concours. Le XVIIIe siècle européen est celui d’une sinomanie largement partagée.
Le monde ottoman constitue une énigme pour l’Europe chrétienne puisque les dirigeants peuvent venir de toutes les classes de la société, voire être des esclaves comme les Mamlouks. Cette possibilité d’échapper aux cadres contraints de la société aristocratique est d’ailleurs l’un des moteurs de la conversion en islam, le prix à payer pour faire carrière en Orient.
La question des origines de la noblesse taraude les auteurs européens. Le fondement qualitatif des hiérarchies sociales n’est plus compris et est remplacé par l’histoire avec la théorie des invasions. Les conquérants germaniques se seraient réparti les biens des populations conquises, constituant ainsi le régime féodal et les monarques ne seraient que les premiers dans un monde de nobles égaux.
Dès lors, les orientalistes se heurtent à la question des invasions arabes, turques et mongoles qui, contrairement à l’Europe, n’ont pas abouti à la constitution d’aristocraties, mais plutôt à des despotismes pesant lourdement sur les populations.
Il n’en reste pas moins que, dans la première moitié du XVIIIe siècle, les empires à la poudre à canon font toujours équilibre aux empires ultramarins de l’Europe et que partout domine une vision statique de l’histoire.
La grande divergence
Autour de la décennie 1750, tout se bouleverse avec d’abord l’émergence, finalement assez brutale, de l’idée de progrès aussi bien dans les Lumières françaises que celles dites écossaises, marquées entre autres par l’usage nouveau du mot « civilisation » comme processus de transformation de soi par soi-même. La flèche du temps, qui, jusque-là, était immobile, s’oriente brusquement vers un futur prometteur. C’est d’ailleurs le moment où les sociétés ouest-européennes entrent dans une croissance économique continue, même si au départ le rythme paraît très faible (de l’ordre de 0,5 % par an).
Dans le même temps, les Britanniques s’emparent du Bengale et se lancent dans la conquête de l’Inde, démontrant ainsi que l’équilibre militaire entre Europe et Orient se trouve rompu, ce qui se trouve confirmé par la guerre russo-turque de 1768-1774 qui met en cause le sort de l’Empire ouvrant ce que l’on appellera plus tard « la question d’Orient ».
Les Français, au contraire, doivent abandonner leurs possessions continentales en Amérique du Nord (sauf la Guyane) mais rapidement les colonies anglaises refusent de se soumettre à l’autorité de la couronne britannique enclenchant le mouvement qui va conduire à l’indépendance des États-Unis.
Autrement dit, on prend conscience à la fois que la phase européenne de l’histoire du Nouveau Monde est en train de s’achever et que l’Europe se trouve en position de superpuissance face à l’Ancien Monde, l’ensemble dans un contexte où un mouvement démocratique est en train d’émerger contestant de plus en plus l’organisation aristocratique et monarchique des sociétés européennes.
Il faut bien saisir que la nouvelle expansion européenne est indissociable de la remise en cause radicale des institutions sociales traditionnelles de l’Europe. Inévitablement ce que l’on a appelé « la révolution atlantique » doit se répercuter sur l’ensemble de l’Ancien Monde. Ainsi la formation d’une société nouvelle fondée sur l’égalité des statuts est indissociable de l’expansion européenne en Asie et en Afrique.
C’est cet ensemble que l’on peut appeler « la grande divergence », la transformation de l’Occident par lui-même et sa volonté d’imposer une transformation des autres sociétés dans le cadre d’une domination directe ou indirecte.
En cela, il faut changer la perception du temps. Les Européens de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ont brusquement le sentiment d’être en avance sur le reste du monde. Cette avance se perçoit par l’écart à leur propre passé mais aussi à l’Orient considéré dès lors comme immobile. On en arrive ainsi à le définir comme un passé dans le présent, c’est-à-dire un monde en retard. Inévitablement cela conduit à postuler que si l’Orient est le passé de l’Europe, cette dernière est son futur. Autrement dit, on se trouve dans une désynchronisation entre les deux mondes.
La projection européenne construit un nouveau récit qui définit l’histoire de l’Orient dans le cadre de la grande divergence. Traditionnellement dans la culture européenne, l’Orient était défini comme la terre des origines, ne serait-ce que par l’histoire religieuse. Maintenant l’objet en mouvement est ce que l’on appelle alors « les sciences et les arts » et qui deviendra au XIXe siècle la « civilisation ».
Les sciences et les arts sont nés en Égypte, ils sont alors vus comme l’expression de la sagesse, puis ils passent chez les Grecs et les Romains avec le civisme pour vertu. Les Arabes reprennent le flambeau en insistant sur les savoirs scientifiques pour aboutir aux Européens qui se trouvent à la fin de l’histoire.
On trouve dans les écrits du temps ce que l’on pourrait définir comme les « Arabes des Lumières » qui ont porté au plus haut les sciences avant de succomber à leur tour aux invasions. Ainsi la domination ottomane est interprétée comme une domination coloniale turque. Dès lors, les Arabes se doivent de se révolter et c’est aux Européens de leur porter secours. Cette idée se trouve déjà dans les derniers écrits de Diderot et devient le discours de la Révolution française finissante avec l’expédition d’Égypte qui se présente tout aussi bien comme une conquête coloniale que comme une entreprise de libération.
Les flèches du temps
L’entreprise de conquête de l’Inde par les Britanniques et le risque de voir l’Empire ottoman s’effondrer sont autant de signaux d’alarme pour les dirigeants orientaux. La première compréhension des dangers aboutit à la volonté de constituer un armement moderne face à la menace européenne, le nizam jadid (« le Nouvel Ordre »). Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, le recours aux renégats ne suffit plus. Les Ottomans doivent accepter l’utilisation de conseillers militaires européens qui gardent leurs religions d’origine. Leur empire réussira à passer les terribles années de la Révolution française et de sa suite napoléonienne en se trouvant à chaque fois dans le bon camp dans la multitude des conflits entre 1787 et 1815. En se rendant indispensables à l’équilibre européen, les Ottomans réussiront à limiter leurs pertes dans un long XIXe siècle qui ira jusqu’à 1912.
Deux voies de résistance existent. La première est celle des sociétés tribales encadrées par des confréries soufies qui se défendent avec acharnement contre la guerre de terreur menée par les Européens. C’est le cas de l’Algérie avec l’émir Abd al-Qadir et du Caucase avec l’Imam Shamil. Les terribles violences de ces guerres ont encore des répercussions aujourd’hui. Les Britanniques doivent accepter leurs défaites dans les deux premières guerres anglo-afghanes et composer avec les tribus de la « frontière du Nord-Ouest » (les actuels territoires tribaux pakistanais).
L’autre résistance est d’adopter l’État moderne européen et ce qui l’accompagne, c’est-à-dire l’égalité des statuts sociaux indissociable d’une fiscalité non discriminatoire et d’un recours à la conscription. En fait, le seul à le faire franchement est l’Empire ottoman.
Un tel choix passe par l’acceptation d’un « retard » sur l’Europe. Il implique une vraie connaissance des réalités européennes qui passe par l’apparition d’une littérature de voyage en Europe aboutissant à de véritables programmes politiques. L’imprimé est au carrefour des tendances de la société nouvelle. Il est vecteur de la modernité, surtout française et anglaise, avec une sorte d’encyclopédie permanente des nouveautés et, en même temps, redécouverte du patrimoine devenu bien plus accessible qu’auparavant. Les deux se combinent dans les options successives de modernité que sont le libéralisme et le nationalisme. À la fin du XIXe siècle, on se saisit des idéologies les plus modernes : les Jeunes Turcs sont des lecteurs revendiqués d’Auguste Comte et d’Herbert Spencer. Ils seront aussi accusés d’être des adeptes du darwinisme social.
Pour comprendre leurs propres sociétés, les occidentalistes ont recours aux travaux des orientalistes qu’ils sont d’ailleurs amenés à rencontrer. Cela implique de reprendre à son compte l’histoire universelle élaborée en Europe. Elle s’est considérablement modifiée au XIXe siècle grâce à la conjonction de la philologie et de l’archéologie qu’incarne en premier un Champollion avec le déchiffrement des hiéroglyphes, puis son expédition archéologique en Égypte dans les années 1820. Dès lors, on entre dans un cycle de découvertes tous les vingt ans : années 1840 déchiffrement du cunéiforme et découverte de l’Assyrie, années 1860 la mission de Phénicie de Renan, année 1880 Sumer, 1900 la Crète minoenne.
Les orientalistes passent de la notion de processus de civilisation à celle de civilisations au pluriel, une société prise dans sa longue durée historique. L’orientalisme procède ainsi à deux flèches du temps, la première orientée vers un passé connu maintenant sur plusieurs millénaires, l’autre vers le futur de l’Orient généralement considéré comme étant une modernisation qui ne peut être qu’une occidentalisation.
Le paradoxe de l’orientalisme est bien là : il s’intéresse en priorité au passé de l’Orient déplorant au passage sa destruction en cours, en même temps qu’il dote les occidentalistes du moyen d’affronter l’avenir. L’histoire des peuples orientaux ainsi considérés constitue les matériaux nécessaires pour pouvoir élaborer un nationalisme spécifique : turquisme, panturquisme, arabisme, phénicisme, syrianisme s’appuient sur les travaux des orientalistes.
L’existence d’un passé glorieux est ainsi la promesse d’un futur radieux. Bien évidemment, l’État moderne oriental ne se construit pas dans le vide. Il s’appuie sur des forces sociales déjà en mouvement. Dans le cas ottoman, c’est d’abord une fraction de l’appareil d’État contre une autre réfractaire aux réformes. Puis c’est la constitution autour de l’État et de l’armée d’un groupe social en pleine expansion numérique caractérisé par une éducation dite moderne.
Les conséquences vont en être redoutables. L’adoption de l’État moderne, considéré par ses promoteurs comme la seule résistance possible, est ressentie par ses adversaires comme une atteinte à la société traditionnelle définie par l’islam. La modernité sera ainsi ressentie comme hostile, imposée d’en-haut. De ce fait, à partir des tanzimats ottomans, on peut parler d’une modernisation autoritaire. Elle se poursuivra dans les régimes militaires de la seconde moitié du XXe siècle.
La grande convergence et ses résistances
La spécificité de la domination européenne est d’être, à l’exception majeure de la Russie, ultramarine, c’est-à-dire d’inscrire dans sa constitution même, une césure entre la métropole et ses colonies. Elle introduit une contradiction croissante entre les deux mondes. En métropole, le processus de démocratisation conduit à une uniformisation croissante des conditions avec l’unification du droit, la généralisation d’une instruction publique commune à tous et l’extension continue des libertés politiques et des services publics.
La domination coloniale est reconnaissance de la pluralité des sociétés prise dans un cadre inégalitaire. Le colonialisme est une gestion permanente de la diversité, jouant d’un côté sur les oppositions de communautés et de l’autre n’arrivant plus à contrôler les oppositions des communautés devenues des acteurs politiques, ce que l’on appelle le « communalism » en Inde ou le confessionnalisme au Moyen-Orient.
Les statuts des populations sont d’abord définis par l’appartenance religieuse : la France en arrive ainsi à codifier ce que l’on appelle le droit musulman, la Grande-Bretagne l’Anglo-Muhammadan law ensuite adaptée par les Russes en Asie centrale. Cet effort juridique qui s’appuie sur les travaux des orientalistes est en liaison avec les évolutions ottomanes tardives puis avec l’œuvre des grands juristes musulmans de la première moitié du XXe siècle.
Parallèlement, les coloniaux s’intéressent aussi au droit coutumier qui peut être en contradiction avec le droit musulman.
La contradiction coloniale est de vouloir à la fois maintenir la domination européenne tout en diffusant les instruments du changement que constituent l’éducation moderne et bientôt les sciences du développement. La resynchronisation des sociétés entraîne nécessairement la délégitimation de la domination étrangère. Cette resynchronisation aboutit à une grande convergence qui commence à des dates différentes selon les époques. Elle est étroitement associée aux processus de mondialisation.
Ainsi à l’horizon 1900, la première puissance musulmane du monde est l’Empire britannique, la seconde la France coloniale, la troisième la Russie impériale. Cette référence est publiquement revendiquée par leurs décideurs politiques. Un siècle après, tout aura été effacé à l’exception partielle de la Russie.
Indépendamment du choc des deux guerres mondiales et des coûts croissants d’administration, le système colonial s’est trouvé délégitimé en apparaissant à son tour comme appartenant au passé. La différence devenait insurmontable avec l’évolution des métropoles qui, nouveau paradoxe, voyaient leur composition modifiée par l’arrivée d’anciens colonisés. Cette fois, il ne pouvait plus être question de pluralité de statuts juridiques, mais d’alignement sur celui des populations métropolitaines avec tout ce que cela comprend de conséquences anthropologiques.
Le discours orientaliste de la première moitié du XIXe siècle, alors que la différence des mondes est à son maximum, postule que le rattrapage de l’Orient sera rapide quitte à lui faire perdre son originalité. Le modèle largement évoqué est celui de l’Égypte des vice-rois puis des khédives. En revanche, au moment où la distance diminue, certains affirment qu’elle ne sera jamais abolie, puisque les civilisations sont des essences presque immuables pouvant éventuellement être définis par une appartenance raciale. La modernité serait une sorte de placage sans véritable ancrage. On retrouve là la critique du modernisme autoritaire.
Tout se joue sur la question de définition de l’islam. Bien entendu, les premiers réformateurs n’avaient pas l’intention d’abandonner leur religion et l’invoquaient régulièrement pour justifier les mesures prises en affirmant qu’il s’agissait de revenir aux bonnes conduites anciennes, mais ils étaient peu crédibles.
Dans les années 1860, avec les Jeunes-Ottomans, on passe par l’islamisation des réformes, c’est-à-dire la création d’une série d’équivalences entre un vocabulaire d’origine islamique et les concepts issus de la modernité. Ainsi les constitutionnalistes vont reprendre le terme de consultation (shura) et la réalité nouvelle de la nation se définira par celui de communauté (umma).
Il existe alors une conjonction avec ceux qui veulent réformer l’islam en faisant une référence explicite au protestantisme interprété comme la clef de la réussite des Anglo-Saxons. Pour pouvoir aborder l’avenir, il faut d’abord revenir au temps des origines.
Ainsi à la fin du XIXe siècle s’opère ce que l’on a appelé la politisation de l’islam c’est-à-dire la volonté d’en faire l’instrument de la résistance à la domination étrangère. Le danger d’une telle entreprise est de ne plus considérer seulement la religion comme régissant les rapports entre le monde d’ici-bas (al-dunyâ) avec Dieu, et l’organisation morale de ce monde, mais aussi comme un contre-modèle par rapport à la modernité occidentale.
L’endogène et l’exogène
La domination étrangère provoque un sentiment d’infériorité que l’on tente de dépasser en minimisant les succès occidentaux et en proclamant sa supériorité morale. Ainsi à la fin du XIXe siècle beaucoup d’Orientaux dévalorisent les succès de l’Occident en les attribuant à un matérialisme vulgaire inférieur aux cultures spirituelles de l’Orient.
Cela se répercute en Occident même avec la vague des spiritualités ésotériques orientales comme la théosophie, le yoga indien ou le soufisme musulman.
Après la Première Guerre mondiale, les Européens se sentent, à leur tour, déclassés par la technique américaine représentée en particulier par une division du travail portée à l’extrême. Ils adoptent alors, sans se rendre compte le même discours que les dominés orientaux, en affirmant une authenticité culturelle supérieure à toute technique. C’est ainsi que se développent toute une série de courants classés aujourd’hui comme « antimodernes », c’est-à-dire rejetant la société égalitaire et laïcisante de la modernité européenne. Certains plus modérés font l’apologie d’une Méditerranée des deux rives, machine à fabriquer de la civilisation opposée à la civilisation de la machine.
L’antimodernisme peut se transformer en mouvements politiques n’hésitant pas à utiliser les technologies les plus récentes de la communication. En identifiant les Juifs à la modernité, ils fournissent un des courants essentiels de l’antisémitisme. De façon plus générale, on accuse les gens de perdre leurs âmes et leurs individualités dans une société de masse manipulée par les médias. On y voit là-encore un ou des complots sous-jacents, généralement attribués aux Juifs mais aussi à d’autres forces occultes.
L’antimodernisme, sorte de signe ultime de la modernité, se retrouve dans les Orients en reprenant le discours des orientalistes du XIXe siècle : il existe bien une série d’essences orientales que l’on appelle civilisations. Elles ont été atteintes par l’agression culturelle européenne et il s’agit maintenant de les restaurer dans leur originalité première. On peut ainsi parler d’un monde musulman, d’une Inde ou d’une Chine qui se pensent comme contre-modèle à l’Occident, mais qui en réalité, par le fait même d’être contre, ne peuvent pas se libérer de ce dernier, indépendamment de la mondialisation des échanges.
Les dégâts monstrueux provoqués par les deux guerres mondiales n’autorisent plus l’Europe à avoir un sentiment moral de supériorité. Les plus grandes atrocités de l’histoire contemporaine ont été commises par des Européens et on a pu à juste titre parler d’Europe barbare. Le nazisme a été en soi une version dévoyée et monstrueuse du colonialisme européen au détriment des Européens eux-mêmes. Inévitablement cela conduit à une remise en cause du colonialisme lui-même qui se trouve ainsi moralement condamné avant de s’effondrer pour toute une série de raisons.
Certes il y a eu une reconstruction morale dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre (1945-1949) en définissant positivement ou négativement ce qui doit être fait : charte des Nations unies, crimes contre l’humanité créés dans le statut international du tribunal de Nuremberg, convention sur la prévention du crime de génocide, Déclaration universelle des droits de l’homme, Conventions de Genève de 1949.
Ce réarmement moral de l’Occident ne deviendra vraiment une force politique que durant les années 1970 avec l’émergence des puissantes organisations non-gouvernementales exigeant partout le respect des droits de l’homme et le secours aux victimes.
Le même processus se retrouve dans la production de nouvelles normes, en particulier en matière de sexualité, avec une forte volonté de les mondialiser.
Développement et Tiers Monde
La constitution de l’État moderne et le projet colonial se définissaient comme une volonté de civilisation qui regroupait les aspects matériels et moraux et, de façon plus prosaïque, par la mise en valeur dont le premier instrument est la constitution d’un réseau moderne de communication (routes, télégraphes, ports, chemins de fer). Ainsi, dès le dernier tiers du XIXe siècle, les pays musulmans se trouvent intégrés dans la première mondialisation, constituant cette réalité nouvelle appelée « monde musulman ».
Ce dernier doit être considéré comme un espace politique traversé par de grands courants d’idées, objet à la fois des convoitises européennes et instrument de résistance à ce danger, d’où l’émergence d’une menace pour la domination européenne définie comme étant le « panislamisme », étape supplémentaire de la politisation de l’islam.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la mise en valeur est remplacée par l’idée de développement qui prend en compte les structures médicales et éducatives à côté des indicateurs matériels. Cette idée triomphe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l’analyse du « sous-développement » (1949), ou plus poliment « en voie de développement ».
Les pays maintenant indépendants se trouvent ainsi définis face aux pays dits industrialisés pris dans le conflit des deux blocs de la guerre froide.
Ce conflit prend la forme d’opposition entre deux projets de développement, le premier d’inspiration libérale se revendique de l’expérience réussie du plan Marshall en Europe, le second socialiste dirigiste des grands plans quinquennaux soviétiques.
En même temps, l’indépendance récemment acquise permet de s’affranchir de la domination en proclamant une solidarité afro-asiatique définie par un affranchissement politique qui autorise de jouer un grand rôle sur la scène mondiale.
Cela aboutit à un mouvement des non-engagés et à la vision globale d’un monde qui ne fait pas partie des deux grands blocs et qui, pour cette raison, prend le nom de « Tiers Monde », expression qui se généralise dans les années 1960. Il s’agit à la fois de revendiquer des réparations matérielles et morales par rapport au passé colonial (flèche orientée vers le passé) et d’affirmer que le futur de l’humanité passe par lui. On peut ainsi constituer un espace tricontinental avec l’Amérique latine qui se positionne comme ni-Est ni-Ouest. On pose ainsi un universalisme de combat anti-impérialiste.
La seconde mondialisation, qui entraîne une désindustrialisation de toute une partie du monde jusque-là définie comme étant industriel, a pour effet paradoxal de mettre fin à cet universalisme du Tiers Monde avec la montée en puissance des « pays émergents ».
Loin de combattre comme auparavant le néo-colonialisme, les pays de l’ex-Tiers Monde, appelé parfois « Sud » font désespérément appel aux investissements étrangers pour poursuivre le développement. Ils essayent de mettre en concurrence les anciens et les nouveaux pays industriels.
Conclusion : les paradoxes de la mondialisation
Très tôt, les pays européens ont importé des produits orientaux dans l’habillement ou dans les objets de luxe. Il y a déjà deux cent cinquante ans, les intérieurs des milieux aisés voyaient se multiplier les meubles « à la manière de » comme les divans ou les sofas.
De même au XIXe siècle, les sociétés orientales se sont saisies des ameublements européens pour les adapter à leurs propres besoins. Les progrès techniques se sont déroulés à peu près aux mêmes rythmes un peu partout dans le monde et ont généralisé les mêmes objets à quelques différences près. On le voit aussi dans l’habillement.
Autrement dit, la culture matérielle est celle qui se mondialise le plus vite et qui finalement pose peu de problèmes.
Il n’en est pas de même pour la culture intellectuelle parce qu’elle sert à définir les identités. Pourtant il faut bien considérer que partout dans le monde les cultures ont été amenés à se reconsidérer en fonction de « la tentation de l’Occident », c’est-à-dire du fait que dans leur propre formulation elles doivent se placer par rapport à l’Occident, et que ce dernier leur a apporté des instruments leur permettant de se repenser. Ce que l’on appelle les Orients aujourd’hui ne sont plus des essences irréductiblement séparées les unes des autres, – elles ne l’ont jamais été –, mais plutôt des retournements des discours occidentaux, les uns et les autres ne s’en rendant pas compte.
Ainsi l’opposition entre le patrimoine et l’importé se trouve déjà dans le romantisme allemand qui opposait la culture germanique authentique à la civilisation française artificielle. Elle s’est poursuivie dans la controverse entre occidentalistes et slavophiles dans la Russie tsariste.
De même les cultures occidentales contemporaines se nourrissent d’une multitude d’apports externes y compris dans la vie quotidienne. L’Occident ne peut se penser sans la multiplicité des Orients qui se trouvent en lui. Il suffit de voir les controverses d’aujourd’hui sur les appropriations culturelles pour s’en rendre compte.
Si la mondialisation actuelle donne l’impression de faire revivre des querelles d’identités dans un monde qui ne finit pas de se ressembler, elles sont bien souvent des guerres civiles, les uns niant la part d’Orient qui est en eux, les autres la part d’Occident.
C’est bien pour cela que la distinction Orient/Occident est en train de s’effacer au profit de l’idée d’un patrimoine commun, le patrimoine de l’humanité, en dépit de la pluralité des discours contraires.

