Par Daniel Meier
Dans l’étude sur les frontières (border studies), force est de noter l’angle mort que constituent les zones d’interstices dans les régions frontalières, qu’ils s’agissent de territoires patrouillés par des casques bleus, de régions occupées par des armées étrangères ou de territorialités émergentes dans des États fragmentés. Tout se passe comme si l’évidence de ces espaces autres, les difficultés relatives au travail de recherche de terrain pour s’y rendre et leur relative exception par rapport à la règle frontalière « stato-national » constituaient un rempart à la connaissance. Pourtant, ces territoires aux souverainetés alternatives renferment un grand nombre d’enjeux épistémologiques, théoriques et empiriques.
Quels points communs y a-t-il entre les classiques « zones tampons » (buffer zones), les no man’s lands et autres safe zones ? Toutes ces appellations visent à décrire un phénomène commun où le territoire est utilisé aux fins d’une interposition entre belligérants. Toutes renvoient à un régime politique d’exception soit par l’interdiction qui est faite aux civils d’y accéder, soit par les mesures de démilitarisation qui s’y appliquent ou encore par l’arrangement territorial qu’elles incarnent en période de conflit. Mais voilà que ces dernières années, plusieurs zones de conflits au Moyen-Orient ont vu ressurgir ces procédés territoriaux par le biais d’occupation militaire à des fins autrement stratégiques comme c’est le cas avec le territoire syrien qui apparaît fragmenté au gré des intérêts de ses voisins, parrains et groupes armés non-étatiques. Qui’en est-il des objectifs poursuivis lesquels semblent contradictoires avec les volontés de désescalade des zones tampons classiques ? Qu’est-ce que ces nouvelles territorialités impliquent en matière de droits pour celles et ceux qui y vivent ? En somme, comment penser ces formes spatiales que prennent les stratégies de pouvoir dans les conflits au Moyen-Orient notamment lorsqu’elles s’adossent à des frontières internationales ?
Penser l’espace interstitiel en politique
De nombreux auteurs dans plusieurs disciplines se sont penchés sur la question des zones grises et des espaces liminaires à travers des concepts qui seront détaillés ici. Afin d’évaluer cette littérature, il est utile de considérer les trois composantes de la problématique des espaces interstitiels que sont l’espace, l’identité et le pouvoir. Soulignons d’abord que ces trois notions sont des constructions sociales, c’est-à-dire qu’elles s’incarnent dans des pratiques, qu’elles sont porteuses de sens et qu’elles connaissent des changements dans le temps. Loin d’être des immanences, elles traduisent la nature dynamique du réel et doivent se penser comme des processus et non des États. En outre, ces trois processus sont interdépendants : le processus de frontiérisation ou bordering (espace) induit, est produit par des formes d’ordonnancement politique ou ordering (pouvoir) qui, ensemble, participent à la figure de l’autre ou othering (identité) autant que cette dernière fournit un récit sur la définition, redéfinition des limites spatiales et politiques du groupe.
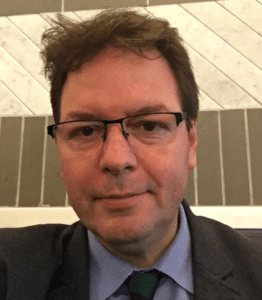
Daniel Meier
Daniel Meier est chercheur associé à PACTE (laboratoire de sciences sociales) et enseignant à Sciences Po Grenoble, ainsi qu’au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Il a effectué de nombreux séjours de recherche au Moyen-Orient depuis 2001 et il est l’auteur de plusieurs monographies sur le Liban et sur les questions de frontières dans cette région.
À la lumière de ces trois processus, on peut évaluer les principaux concepts que l’on trouve dans la littérature. Le premier terme qui est aussi le plus classique est celui de zone tampon (buffer zone[1]). Dispositif de la guerre moderne, il trouve une place de choix dans la tradition réaliste où seuls les États étaient des acteurs politiques. L’accent est porté sur la géopolitique (l’espace tampon), et aussi sur l’idée de relation de pouvoir asymétrique et de flexibilité stratégique. En effet, le terme peut décrire aussi bien une zone démilitarisée qu’un espace territorial occupé par un État tiers sur une fraction du territoire d’un État failli. Loin d’être une simple « zone de séparation », selon la terminologie officielle de l’armée américaine, la zone tampon met en lumière un enjeu de pouvoir. Une déclinaison possible contemporaine de ce terme, appliquée au contexte d’élargissement spatial et institutionnel des frontières européennes, est celui de borderlands décrivant les voisins du sud de la Méditerranée comme des États tampons autour de l’UE auxquels la gestion des frontières extérieures européennes a été confiée en contrepartie de soutiens financiers et/ou politiques[2]. Malgré cela, ce concept de zone tampon plutôt descriptif ne laisse aucune présence aux questions identitaires, comme si les individus y résidant étaient quantité négligeable. Il a fallu attendre l’investissement des border studies pour que les notions de frontiers (limites d’empires) et borderlands (régions frontalières) réinscrivent la zone tampon dans des rapports de pouvoir où les enjeux identitaires ont un impact sur la définition même du lieu tout en mettant l’accent sur la dimension possiblement conflictuelle qui peut en émerger.
Dans les années quatre-vingt-dix, la notion de « zone grise[3]» était devenue à la mode pour décrire des espaces de dérégulation échappant au contrôle de l’État. Ce terme très stato-centré était surtout le fruit d’un contexte historique spécifique, celui de la montée des incertitudes pour les États dans l’ère post-bipolaire[4]. L’enjeu était assez problématique tant sa focale sur l’enjeu sécuritaire faisait des populations résidantes dans ces zones « grises » des individus pour le moins suspects. Ce retour de l’acteur par la marge sécuritaire tendait plutôt à dépolitiser l’espace par une classification nouvelle en zone douteuse ou frappée d’illégitimité en raison des pratiques et des acteurs qui y évoluaient. Peu satisfaisant et largement biaisé par une lecture d’époque, le terme de « zones grises » n’a jamais réellement été un concept solide tant il permettait d’agglomérer des réalités fort disparates (délinquance, quartiers sensibles, terrorisme, narcotrafic et autres mafias) pour les besoins d’une démonstration ayant une finalité sécuritaire.
Un autre terme, celui de « liminalité » qui est issu d’une tradition plus anthropologique, prend un peu le contre-pied des précédents tant il met l’accent avant tout sur le processus de transition identitaire. Il décrit ainsi le stade « liminal », celui de l’entre-deux (in-betweenness), en insistant sur le processus de changement, le fameux « rite de passage[5]», tant des structures sociales que de la subjectivité des acteurs. Le courant du transnationalisme féministe en a fait un usage critique en l’utilisant pour appréhender les lieux liminaux (espaces d’exclusion, centre de détention) au niveau de leurs impacts intimes[6]. La notion de borderscape suit cette inspiration et traduit en terme plus géographique l’idée de liminalité, en mettant l’accent sur le processus d’appropriation ou de transformation des espaces frontaliers par les acteurs locaux, qu’ils soient résidents, migrants ou réfugiés[7]. L’identité semble ici fonctionner en lien direct avec l’espace dans un cadre politique qui s’incarne dans des normes contraignantes.
Ces liens entre identité et espace sont en jeu dans la notion plus classique de « marge » ancrée dans la sociologie et la théorie de la dépendance, avec une portée à la fois temporelle et spatiale. Si elle semble moins évocatrice que la liminalité en termes de processus de changement, la « marge » met en évidence la relation asymétrique du pouvoir avec le centre et implique une relation duale comme un aspect clé de celle-ci et pose donc la question de la polarité géographique centre-marge[8]. La « marge » renvoie également à un espace relégué et à des catégories d’acteurs situés entre les frontières et remettant ainsi en cause l’ordre des espaces bornés[9]. Mais les marges et leurs composantes sociales peuvent aussi conduire à plus d’autonomie et à un rapport plus détaché avec le centre. Dans ce cas, ce qui était autrefois en marge n’est plus marginal, ce qui souligne l’assignation identitaire unilatérale que comportait cette notion d’espace (marge), de son peuple (marginalisé) et de son processus de formation (marginalisation). Pour sa part, la notion de frontier, décrivant originellement les limes d’empires, a été revisitée comme dérivée socio-spatial des conflits de pouvoirs anciens et nouveaux[10]. Sa force évocatrice, à la jonction d’une approche de sociologie politique et de géographie politique, spatialise le pouvoir, socialise l’espace et permet de penser la conflictualité comme dérivé d’une trajectoire socio-spatiale propre.
Un dernier terme, celui de no man’s land, retient aussi l’attention. Récemment, des géographes britanniques en ont relevé deux caractéristiques fondamentales : l’abandon et la fermeture (abandonment and enclosure[11]). Le premier terme souligne le lien entre le territoire et le pouvoir puisqu’il réfère à l’idée de bannir une zone tout en lui appliquant un régime de gouvernance d’exception. Le second terme porte plutôt sur la relation entre espace et identité : la ségrégation spatiale par l’érection de murs ou barrières le délimitant définit a priori les populations isolées, avec toutefois un contre-effet puisque le bannissement territorial a de fortes chances de provoquer des mobilisations contre cet ordre des choses parmi les bannis.
Aujourd’hui, les espaces intermédiaires apparaissent comme un champ de recherche émergent[12], notamment dans les études urbaines. Pour tenter d’arriver à une définition, Brighenti déclarait que « “l’entre-deux” fait référence au fait d’être entouré d’autres espaces qui sont soit plus institutionnalisés, et donc économiquement et juridiquement puissants, soit dotés d’une identité forte, et donc plus reconnaissable ou typique[13] ». L’espace interstitiel, tel qu’il est envisagé apparaît donc comme un espace peu régulé, faiblement institutionnalisé, fragile et mouvant dans le sens où il génère des sujets interstitiels, des minorités et des acteurs relégués qui, en pareil contexte, sont susceptibles de saisir toute opportunité afin de redéfinir et transformer leur environnement.
Le double visage des espaces interstitiels aux frontières
Pour l’analyse, on fera un distinguo entre des espaces interstitiels reconnus et des espaces non reconnus internationalement. En détail, cela distingue donc en premier lieu des dispositifs territoriaux comme les zones tampon ou no man’s land possédant des garanties institutionnelles étatiques et internationales permettant le respect de règles de droits pour ceux qui y vivent malgré le statut particulier du territoire. La reconnaissance de jure du statut de ces zones interstitielles, résultant d’une entente entre parties belligérantes est un point clé garantissant une certaine stabilité, sans que cela signifie que ce statut soit immuable. Imaginés dans le cadre de la Convention de Genève (1951) pour protéger les populations civiles sur le court terme dans le cadre du conflit, ces dispositifs ont été progressivement étendus dans le temps comme modalité post-conflit. Dans cette catégorie, on trouve les interpositions onusiennes à Chypre ou sur le plateau du Golan où le paradigme de « la bonne frontière » démilitarisée génère de « bons voisins », selon une formule classique de l’ingénierie de la paix, une formule reprise pour justifier la construction de murs frontaliers dans la lutte anti-terroriste[14].
Toutefois, la réalité sur le terrain a montré certaines limites de ce modèle : les causes profondes des conflits ne sont pas débattues ou négociées et conduisent à éterniser ces solutions provisoires, processus souligné par les chercheurs qui se sont penchés sur les dynamiques contemporaines du post-conflit[15]. Ou bien ce sont les belligérants qui ne respectent pas le cadre formel onusien et utilisent les espaces d’interposition comme autant de gains territoriaux. Les cas d’Israël, puis du Hezbollah au Sud-Liban depuis l’an 2000, illustrent bien ce travers. En effet, dès le moment où les casques bleus de la FINUL (Force Intérimaire de Nations Unies au Liban) ont pu se déployer jusqu’à la frontière internationale après le retrait militaire israélien, les violations ont concerné les deux belligérants avec des actions terrestres (comme des enlèvements, des caches d’armes, le creusement de tunnels sous la frontière) du côté du Hezbollah, mais aussi d’Israël (enlèvement de bergers, empiètement au-delà de la ligne bleue) incluant des tirs d’armes légères et lourdes et des violations de l’espace aérien à visée d’espionnage. L’essentiel de ces violations étant le fait d’Israël avec plus de 10 000 violations de l’espace aérien libanais par la chasse israélienne selon le gouvernement libanais, depuis l’avènement de la Seconde république (1990). Depuis la guerre de 2006 et la résolution onusienne 1701, le Hezbollah a montré sa capacité à contourner la présence onusienne grâce à ses réseaux locaux et au sein des renseignements de l’armée libanaise, alors qu’Israël mettait à mal l’opération onusienne par la continuation de ses violations aériennes, mais aussi par une opération de délégitimation de l’efficacité de la mission onusienne sur la scène diplomatique internationale[16].
En second lieu, on trouve toute une série d’espaces territoriaux non reconnus internationalement, imposés par des États ou acteurs non-étatiques, les seconds étant parfois soutenus par les premiers, dans des contextes de guerre et d’effondrement des États. Ces territoires sont dominés mais aussi fragmentés par l’ordre milicien, qu’ils soient à la solde d’un État voisin ou non. Leur occupation procède de règles arbitraires sans aucune garantie juridique pour les populations y résidant et souvent sans aucun observateur extérieur. Ils forment donc ce qu’on peut appeler des « espaces d’exception[17] ». L’instabilité institutionnelle est ici au principe d’une durée de vie traditionnellement plus brève de ce second type de zones interstitielles, en fonction des fluctuations et retournements géopolitiques. Ces safe zones ou buffer zones tendent à montrer l’envers du décor de l’ordre juridico-étatique, indépendamment des acteurs étatiques ou para-étatiques qui les soutiennent et en organisent l’occupation. Il convient donc de les lire comme des révélateurs de la faiblesse des catégories prédéfinies par l’ordre politique autant que celle des institutions. C’est vers ces espaces que notre regard voudrait maintenant se porter afin d’en cerner les ramifications historiques autant que les tenants politiques.
Derrière les territoires en fragments, des pouvoirs en crise
Les conditions de production actuelles du foisonnement de territorialités alternatives mettent en avant, au revers de l’histoire récente de la région, le rôle clé des gouvernements occidentaux puis régionaux dans la brutalisation des territoires et de leurs populations. Il faut se déprendre de la tendance à ne se focaliser que sur les acteurs les plus spectaculaires que sont l’État islamique ou les jihadistes de Hayat Tahrir al-Sham dans la poche d’Idlib pour évoquer l’émergence de ces territoires interstitiels ; ce serait oublier à peu de frais ce que la géopolitique impériale puis les intérêts des dirigeants des États ont fait à la géographie et, ce faisant aux populations. Qu’il suffise ici de rappeler avant tout le rôle pour le moins déstructurant des puissances mandataires française et britannique qui, dès la fin du XIXe siècle, n’ont pas hésité à tracer unilatéralement des frontières et à utiliser les territoires à leur guise et suivant leurs intérêts : du marchandage de l’accès maritime de l’Irak en fonction des impératifs diplomatiques britanniques au Koweït et avec l’Arabie Saoudite, jusqu’au don à la Turquie kémaliste par la France du détroit d’Alexandrette amputé à la Syrie afin de s’assurer du non engagement d’Istanbul au côté des forces de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale. Avec les indépendances, on ne peut guère oublier ensuite les ambitions territoriales israéliennes sur les terres palestiniennes, syriennes et égyptiennes dans la mesure où elles ont entériné la règle du plus fort dans le jeu des relations internationales au Moyen-Orient. Pour leur part, la majorité des régimes arabes ne se sont pas privés de développer des entreprises de nationalisations de territoires habités par des minorités (Kurdes, Saharouis) au détriment des droits de ces derniers et malgré des revendications identitaires et territoriales légitimes. Façon de dire en somme que les entreprises contemporaines de prédations des espaces frontaliers ne surgissent pas du néant et que l’inachèvement des États de la région ou leur faiblesse institutionnelle a aussi des répercussions sociales et territoriales[18].
La période de la guerre froide a imposé l’idée d’une sujétion des espaces territoriaux à des desseins stratégiques, reléguant les populations loin derrière les priorités des gouvernants tant au Nord qu’au Sud. Au Moyen-Orient, plusieurs enjeux territoriaux furent marqués à des degrés divers par la logique bipolaire. Si le cas le plus emblématique fut l’occupation soviétique de l’Afghanistan, le Yémen fit également les frais de cet ordre global ; le Yémen du Sud socialiste subissant les attaques de l’Arabie Saoudite dès la fin des années soixante avec notamment des visées territoriales. Dans une moindre mesure, l’occupation israélienne du Sud-Liban dès 1978 prenait place dans cette confrontation Est-Ouest qui redoublait le clivage entre la lutte révolutionnaire palestinienne portée par l’idéal socialiste et l’Etat d’Israël, sentinelle étatsunienne au Moyen-Orient. L’opération israélienne avait alors pour objectif déclaré de repousser les fédayins palestiniens en introduisant une zone tampon à l’intérieur du Sud-Liban afin d’empêcher leurs incursions armées en territoire israélien. Malgré le vote d’une résolution onusienne (425) condamnant cette violation territoriale et le déploiement subséquent de casques bleus, Israël confia, lors de son retrait, le contrôle d’une bande frontalière d’une profondeur de dix kilomètres à une milice libanaise armée et financée par l’État hébreu instituant ainsi les prémices de la « zone de sécurité[19] ». Après 1982, la dynamique Est-Ouest dans ce conflit s’estompa pour devenir une lutte de libération nationale traversée également par la montée du chiisme militant et bientôt monopolisée par le mouvement islamiste chiite du Hezbollah[20]. Confinée, séparée du Liban par une frontière militaire et satellisée par Israël, la population du Sud-Liban a vécu 22 années sous le joug d’une puissance qui y a établi un ordre politique fondé sur la collaboration, l’arbitraire et la peur. Au cœur de cette zone tampon, la prison de Khiam où des militants palestiniens et libanais ont été enfermés sans procès et systématiquement torturés symbolisa ce système en dehors de toute juridiction[21].
Un autre espace confiné, celui de Gaza, est venu occuper le devant de la scène régionale depuis les années 2000. Là aussi, une population prise en otage fait les frais d’une mesure mêlant l’abandon territorial par Israël après 2005 et l’enfermement spatial, y compris dans la zone maritime[22] et sur le plan digital[23]. À chaque confrontation militaire (2008, 2012, 2014, 2021), on redécouvre l’invraisemblable ostracisme politique et les sanctions inhumaines qui frappent les résidents de cette bande territoriale décrite comme une prison à ciel ouvert. Le refus occidental de dialoguer avec les acteurs politiques de Gaza, qualifiés de « terroristes » sous l’influence idéologique israélienne, permet de ratifier tacitement un régime de sanction qui confine à la punition collective, pourtant condamnée par le droit international. Cet espace interstitiel apparaît ainsi comme une sorte de co-construction israélo-occidentale qui bannit toute une population palestinienne dont il devient impossible d’ignorer les revendications identitaires et spatiales légitimes. Gaza démontre empiriquement que les espaces interstitiels géopolitiques sont aussi des outils dont les démocraties peuvent se doter à des fins de relégation diplomatico-politique et contre tous les principes des droits humains tant défendus ailleurs.
En Syrie, depuis le soulèvement populaire de 2011, le territoire national s’est fragmenté avec notamment plusieurs espaces interstitiels frontaliers. Ils sont le fruit de rapports de force locaux entre des acteurs internes et internationaux qui chacun poursuivent des objectifs propres. Le cas emblématique et le plus médiatisé est celui de l’occupation turque d’une bande territoriale adjacente à sa frontière sud, inaugurée en 2016 avec l’opération « Bouclier de l’Euphrate » (août 2016-mars 2017) et poursuivie les années suivantes avec deux autres invasions, « Rameau d’Olivier » (janvier 2018) et « Source de Paix » (octobre 2019), ayant pour but officiel de repousser les combattants de l’Etat islamique. Officieusement, il s’est surtout agi pour Ankara de faire pièce à la constitution d’un territoire kurde frontalier, politiquement proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) turc, en créant une discontinuité entre les zones kurdes en Syrie tout en les coupant de leur arrière-pays kurde en Turquie. Ankara n’a toutefois pas pu étendre son contrôle territorial à l’est de l’Euphrate jusqu’à la frontière irakienne ; elle a tout de même réussi à occuper une bande territoriale de 30 à 40 km de profondeur entre Tel Abiyad et Ras el-Ayn d’environ 1 000 km2. Les réfugiés syriens en Turquie ont même été utilisés pour justifier de la dernière opération terrestre (2019) afin de constituer une région permettant leur « retour » en Syrie[24]. La zone tampon ainsi créé sous l’autorité de l’armée turque a été en partie confiée à une milice locale stipendiée par Ankara et constituée d’ex-combattants de l’Armée syrienne libre et d’anciens jihadistes[25]. Il en a découlé de nombreuses exactions à l’encontre des populations civiles kurdes qui résident dans la zone, illustrant fort bien de la faible régulation de ce territoire interstitiel, sa volatilité autant que de l’abandon de ses résidents au bon vouloir des entrepreneurs territoriaux et leurs séides.
Le territoire syrien comme enjeu de pouvoir s’est évidemment révélé avec le processus d’Astana (2017) parrainé par la Russie, la Turquie et l’Iran et la constitution de safe zones ou « zones de désescalade » formées d’enclaves territoriales où l’opposition au régime était cantonnée. Or, ce qui pouvait se lire comme la constitution de poches humanitaires s’est révélé être une stratégie politico-militaire visant plutôt à les isoler les unes des autres, permettant ainsi au régime syrien de les réduire militairement par les moyens les plus violents et les plus coûteux en vie humaine[26]. Toutefois, ce qui était possible pour la Ghouta, Homs ou Hama s’est avéré beaucoup plus problématique pour Idlib sans parler de la décision quasi unilatérale américano-jordanienne de décréter une zone de désescalade autour du passage frontalier de al-Tanf avec la Jordanie. Là, s’est constitué un régime d’exception incarné par la situation des réfugiés dans le camp de Rukban. Créé par la Jordanie avec le soutien étatsunien qui y a implanté une base militaire à al-Tanf, ce territoire qui englobe ce camp est une zone de sécurité démilitarisée tracée au compas et large de quarante miles de rayon en partant de la base militaire, proche du passage frontalier. La Jordanie a ainsi pu limiter l’immigration syrienne en parquant les réfugiés syriens dans cette zone interstitielle, en territoire syrien mais sous son contrôle discrétionnaire avec une claire fonction de rétention migratoire. Dans cette zone interstitielle dénuée de toute infrastructure médicale, les réfugiés syriens se sont retrouvés pris au piège lors des hivers rigoureux et face à diverses maladies dont la crise de la Covid-19, les autorités jordaniennes refusant de les laisser entrer sur son territoire, même pour d’autres soins médicaux, sans un test Covid-19 négatif. Ou comment la justification sanitaire « covidienne » a servi de béquille à des politiques territoriales très discutables quant à leur impact humanitaire. La seule possibilité pour les quelque 12 000 résidents du camp de sortir de cette zone est un test Covid-19 offert par le Croissant rouge dépendant du ministère de la Santé syrien et impliquant un transfert des bénéficiaires vers Homs, aujourd’hui en zone contrôlée par le gouvernement de Bachar el-Assad[27]. Or ce sont précisément de tels tests qui leur sont demandés pour pouvoir accéder aux centres de santé onusiens qui se trouvent du côté jordanien de la frontière…
À l’inverse, le statu quo d’Idlib, où règne un ordre politique dominé par des factions islamistes, provient non pas tant de la crainte de commettre un massacre en cas de reprise militaire mais plutôt de sa situation géographique frontalière avec la Turquie. Ankara a négocié avec la Russie des lignes rouges et refuse de voir des millions de réfugiés syriens affluer sur son territoire en cas d’attaque loyaliste sur Idlib. Prise en otage par les puissances régionales dans un jeu complexe d’influence, cette zone interstitielle n’en a pas moins vu ses acteurs islamistes issus de la branche locale d’ al-Qaïda et regroupés au sein de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) développer des stratégies propres de survie, combinant à la fois l’internationalisation, et un projet politique hégémonique d’ouverture et de normalisation sur le plan interne[28]. Cette identité interstitielle qui s’est ainsi développée dans le projet politique « révolutionnaire » de HTS est basée sur le contrôle et la pérennité de cette poche territoriale, soumise à de nombreuses pressions régionales. Ce projet entend s’appuyer sur la consolidation de sa base interne et sur le développement d’une plus grande acceptation politique à l’extérieure notamment par l’élaboration d’une ligne modérée qui, loin de la rhétorique religieuse rigoriste, s’adosse plutôt à une rationalité politique fondée sur l’alliance avec les autres mouvements rivaux ou à leur contrôle par la force, si nécessaire.
Enfin, dans le Nord-Est syrien, un important territoire kurde unifiant initialement les trois zones kurdes du nord frontalier du pays en une entité, le Rojava, est actuellement contrôlé de façon monopolistique par les unités militaires (Les Forces Démocratiques Syriennes ou FDS) du parti de l’union démocratique ou PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat), une branche locale du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) de Turquie. Là également, dans ce territoire enclavé, qui reste à la merci de la stratégie turque et, en contre-point du bon vouloir de la protection américaine, la direction kurde syrienne s’est tournée vers l’extérieur pour pouvoir protéger son territoire et a signé dès l’automne 2019, sous l’égide de la Russie, un accord avec le régime syrien pour permettre le retour d’un nombre limité de soldats d’une armée syrienne affaiblie à la frontière turque comme bouclier face à toutes velléité de conquête territoriale turque[29]. Sur le plan intérieur, le PYD a développé un projet politique d’administration autonome depuis 2012 adossé à l’idéologie prônée par le leader du PKK Abdullah Öcalan (emprisonné depuis 1999 en Turquie) d’un municipalisme libertaire de type collectiviste, largement inspiré par Murray Bookchin, un penseur américain de la Nouvelle Gauche. Ce projet de « confédéralisme démocratique » entend dépasser le modèle d’appartenance stato-national et, comme à Idlib, vise ainsi à forger une forme d’identité interstitielle qui n’est pas sans éviter l’écueil du nationalisme kurde[30]. La consolidation de l’ordre institutionnel ainsi impulsé et politiquement cadré semble moins le fait d’une adhésion des populations du Nord-Est (Kurdes et Arabes) à ce projet que découlant de la « fonctionnarisation » d’une partie de la population, la réappropriation de l’administration par d’importants segments de la société et l’absence d’alternative[31]. Sur ce dernier point, on doit observer le développement d’une autre forme d’identité interstitielle émanant de l’État islamique qui a relancé, en marge de ses opérations armées, un système d’encadrement social des populations dans les zones de marges territoriales (comme à l’est de Deir ez-Zor). D’autre part, il est impossible de ne pas mentionner les milliers de prisonniers de l’État islamique dans les prisons kurdes, dont la plupart sont des membres des familles de jihadistes. La relégation de la gestion de ces prisonniers aux FDS dans cette zone interstitielle par les États-Unis avec l’assentiment des puissances occidentales, qui y ont un certain nombre de nationaux, témoigne bien de l’émergence d’une identité interstitielle les concernant. Dépouillés de leurs droits nationaux ou abandonnés par leur gouvernement, ces acteurs, majoritairement des femmes et des enfants, survivent enfermés dans des camps dont certains comme al-Hol deviennent des zones de non-droits, mais aussi des passoirs desquelles les jihadistes s’évadent avec l’aide d’assaillants[32]. L’insuffisance des moyens que les forces kurdes peuvent mobiliser explique en partie ces scénarii, mais il n’est pas à exclure que ces prisonniers puissent fonctionner comme une sorte de levier de pression utilisé par les acteurs kurdes face aux puissances occidentales. Ce ne serait là qu’un retour de la logique instrumentale qui a guidé l’action occidentale à l’égard des Kurdes du Rojava dans sa lutte contre l’EI. Preuve s’il en est que les populations des zones interstitielles peuvent se trouver entre elles dans des rapports agonistiques ou des rapports de sujétions du fait même de la faible institutionnalisation des normes.
Enfin, en Irak, il existe un autre scénario d’espace interstitiel un peu plus ouvert mais tout aussi volatile depuis la chute du régime de Saddam Hussein, incarné par des territoires disputés entre Erbil et Ankara, depuis l’avènement du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK)institué par la nouvelle Constitution (2005). D’une superficie d’environ 30 000 km2, ces zones peuplées de Kurdes, d’Arabes et diverses minorités ont été soumises, depuis les années 1960 déjà, à des politiques d’arabisation et de déplacement forcé de population par le régime baathiste avec comme enjeu de cette ingénierie démographique un plus grand contrôle institutionnel sur les hydrocarbures dont le sous-sol regorge[33]. Malgré un dispositif constitutionnel favorisant une solution territoriale basée sur un référendum, depuis 2005, les autorités irakiennes et kurdes ont montré peu d’empressement à trouver un terrain d’entente, recourant plutôt à l’instrumentalisation des identités locales à des fins politiques. Cette situation a eu deux conséquences délétères : un grignotage territorial kurde qui a permis jusqu’en 2017 l’exploitation du pétrole en contournant l’autorité de Bagdad. Autre effet du vide d’autorité dans ces zones : l’émergence de milices locales soutenues par des puissances régionales (Turquie, Iran) ou des groupes kurdes antagoniques (PDK, PKK) afin de garantir la sécurité de certaines populations ou groupes minoritaires, comme les Yézidis[34]. Et pour aggraver la situation, la reprise des actions armées de l’EI à l’encontre des peshmergas ou de la population locale – en ciblant par exemple les ressources alimentaires – a contribué à renforcer la logique de « milicianisation », engendrant un cycle de violence hors de tout cadre institutionnel capable d’imposer les normes étatiques aux forces locales de facto. Enfin, il convient d’ajouter l’intervention plus massive de l’armée turque depuis le début de l’année 2022 et son implantation dans une zone tampon frontalière d’une profondeur de 25 kilomètres à l’intérieur de l’Irak[35]. Cette opération cible évidemment le PKK mais aussi les unités combattantes des kurdes syriens, avec le soutien des autorités du Gouvernement Régional du Kurdistan (GRK) et l’assentiment d’une fraction de l’État irakien[36]. On le voit, l’espace interstitiel est avant tout un enjeu de lutte entre acteurs rivaux, prêt à instrumentaliser les acteurs locaux d’autant plus directement que les enjeux territoriaux recèlent des richesses naturelles exploitables. Ce faisant, ses aléas permettent de le lire également comme un révélateur des déséquilibres intérieurs et des rapports de forces régionaux.
Conclusion
Cette contribution visait à poser la question de l’étude des espaces interstitiels aux frontières et des moyens conceptuels et empiriques qu’implique leur étude. En particulier, nous avons voulu ouvrir le débat sur la question de savoir « comment nommer » avant de nous intéresser à une typologie possible et des cas d’études de zones non régulées – les zones régulées étant mieux connues quoique pas forcément mieux documentées en matière d’études de terrain. On peut à ce stade tirer quelques conclusions : d’une part, l’espace interstitiel n’est pas aisément saisissable sur le plan conceptuel – les options théoriques examinées l’illustrent bien – mais plusieurs caractéristiques semblent récurrentes : il s’agit avant tout d’un espace peu régulé, faiblement institutionnalisé, mouvant et fragile, aléatoire dans sa durée temporelle et géographique ; en outre les acteurs qui y évoluent (lorsqu’il y en a, c’est-à-dire dans la majorité des cas) sont des sujets interstitiels au plan statutaire, minorités ou acteurs relégués mais qui sont capables de saisir toute opportunité pour redéfinir et transformer leur environnement et, par ce fait, leur statut. Sur le plan typologique, la division la plus évidente mais qui n’en exclut pas d’autres a priori, est celle différenciant les espaces internationalement reconnus et ceux qui ne le sont pas. Le continuum entre les deux s’opère lorsqu’on observe l’incapacité des premiers à normaliser une situation d’exception qui, quoique régulée, n’empêche pas les abus, les violations de droits et les conflits armés d’éclater.
Enfin, en parcourant quelques cas emblématiques dans la région, anciens ou plus récents, force est de noter que la multiplication des espaces interstitiels s’inscrit de plus en plus dans des stratégies d’acteurs étatiques ou para-étatiques visant à tirer profit de la géographie mais aussi de l’affaissement des normes internationales. En jeu un redéploiement des pouvoirs lié notamment au désengagement américain (ou à son déploiement sélectif et limité) qui, en contre-point de l’emprise croissante de l’acteur russe dans la région, ouvre une période d’interrègne[37], mais aussi d’émergence d’une gouvernance régionale plus hétérachique. L’hétérarchie en relations internationales permet de penser au-delà des paradigmes classiques (de la hiérarchie versus de l’anarchie) en constatant la multiplication et l’hétérogénéité des centres de pouvoirs, différentes hiérarchies de pouvoir, la fragmentation des normes régionales et un rôle toujours plus significatif des acteurs transnationaux et non-étatiques[38]. L’importance de situer le débat au-delà d’une lecture bipolaire renouvelée – notamment depuis la guerre en Ukraine – conduit à mettre en avant les stratégies des acteurs étatiques ainsi que des forces irrégulières ou d’acteurs hybrides[39]. Il y a donc bien des variables lourdes inhérentes à la géopolitique qui affectent les espaces interstitiels aux frontières mais, dans le même temps, ces dynamiques de fonds n’empêchent pas les acteurs de déployer des stratégies identitaires propres comme on le voit avec le PYD au Rojava ou HTS dans la poche de Idlib.
Notes :
[1] Lionel Beehner, Gustav Meibauer, “The futility of buffer zones in international politics”, Orbis, Vol. 60, No 2, 2016, pp. 248-265.
[2] Raffaella Del Sarto, “Borderlands: The Middle East and North Africa as the EU’s Southern Buffer Zone”, in D. Bechev and K.Nicolaydis (eds.), Mediterranean Frontiers: Borders, Conflict and Memory in a Transnational World, London, I.B.Tauris, 2010, pp. 149-166.
[3] Pierre Pascallon (dir.), Les zones grises dans le monde d’aujourd’hui. Le non-droit gangrène-t-il la planète ? Paris, L’Harmattan, 2007 ; Gaidz Minassian, Zones grises. Quand les États perdent le contrôle, Paris, CNRS Editions, 2018.
[4] Amaël Cattaruzza, « Zones grises et interstices durables de la carte politique ? Relecture critique d’un concept géopolitique », Bulletin de l’Association des Géographes français, No 1, 2012, pp. 104-120.
[5] Arnold Van Gennep, The Rites of Passage. A Classical Study of Cultural Celebrations. Chicago: University of Chicago Press, 1908.
[6] Alison Mountz, “Where axylum-seekers wait: feminist counter-topographies of sites between states”. Gender, Place and Culture, Vol. 18, No 3, 2011, pp. 381-399.
[7] Chiara Brambilla, “Exploring the critical potential of the Borderscapes concept”, Geopolitics, Vol. 20, No 1, 2015, pp. 14-34.
[8] Julie Peteet, “A fortress country and a gated enclave: Locating the Palestinian margins”, Bir Zeit University Working Paper 2011/17. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1764249
[9] Svetlana Bankowskaya, “Living in-between: The Uses of Marginality in Sociological Theory”, Russian Sociological Review, Vol. 13, No 4, 2014, pp. 94-104.
[10] Liam O’Dowd, “Violent Conflict on the Frontier: The Importance of History”, Paper presented to the First ABS World Conference, University of Eastern Finland, Joensuu, 9-13 June 2014.
[11] Noam Leshem, Thomas Pinkerton, “Re-inhabiting no man’s land: Genealogies, political life and critical agendas”, Transactions, Vol. 41, No 1, 2015, pp. 41-53.
[12] Daniel Meier, « No Man’s Land et zones grises », in A.-L. Amilhat-Szary et G. Hamez (dir.), Frontières, Armand Colin, Coll. “Capes Agrégation”, Paris, 2020, pp. 266-273.
[13] Andrea Mubi Brighenti, “Introduction” in A.M. Brighenti (ed.), Urban interstices: The aesthetics and the politics of the in-between, Farnham: Ashgate, 2013, p. XV–XXIII.
[14] Nazli Avdan, Christopher F. Gelpi, “Do Good Fencs make good neighbors? Border barriers and the transnational flow of terrorist violence”, International Studies Quarterly, Vol. 61, Issue 1, 2017, pp. 14-27.
[15] Amaël Cattaruzza, Anne-Laure Amilhat-Szary (dir.) «Frontières de guerre, frontières de paix», L’espace politique, Vol. 33, No 3, 2017. https://journals.openedition.org/espacepolitique/4400
[16] On se souvient de la visite hautement politique en juin 2017 de l’ambassadrice américaine Nikki Haley à la frontière nord d’Israël dans la perspective d’une mise en cause américaine du bien-fondé de la mission onusienne de la FINUL. Cf. L’Orient-le Jour, 26 août 2017. https://www.lorientlejour.com/article/1069281/violente-attaque-verbale-de-washington-contre-les-casques-bleus.html
[17] Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, Standford, Standford University Press, 1998.
[18] Raffaella Del Sarto, “Contentious Borders in the Middle East and North Africa: Contrast and Concepts”, International Affairs, Vol. 93, No 4, 2017, pp. 767-787.
[19] Sur les détails de ce processus, cf. Beate Hamizrachi, The Emergence of the South Lebanon Security Belt. Major Saad Haddad and the Ties with Israel, 1975-1978, New York: Praeger, 1988. Pour une vue d’ensemble sur la relation entre les supplétifs pro-israéliens, la FINUL et les fédayins, cf. Daniel Meier, Shaping Lebanon’s Borderlands, London, I.B.Tauris, 2016.
[20] Sabrina Mervin (dir.), Le Hezbollah, état des lieux, Paris, Actes Sud, 2008 ; Ferdinand Smit, The Battle for the South Lebanon. The Radicalisation of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985, Amsterdam, Bulaaq, 2000.
[21] Stéphanie Khouri, « Prison de Khiam : des archives inédites révèlent le degré d’implication du Shin Beth », L’Orient-le Jour, 24 mars 2022.
[22] Sur la dimension des frontières maritimes de Gaza, cf. Anais Antreasyan, “Gas Finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel, and Other Conflicts”, Journal of Palestine Studies, Vol. XLII, No 3, Spring 2013, pp. 29-47
[23] Helga Tawil-Souri, “Digital Occupation: Gaza High-Tech Enclosure”, Journal of Palestine Studies, Vol. 41, N° 2, hiver 2012, pp. 27-43.
[24] C’est le même argument de type nationaliste que le Président turc en perte de vitesse dans les sondages à remobilisé fin mai avec l’annonce d’une quatrième invasion du nord syrien, illustrant ainsi en quoi les zones tampons peuvent avoir des objectifs de politiques intérieures. Cf. Marie Jégo, «La Turquie s’apprête à lancer une nouvelle intervention militaire au nord de la Syrie», Le Monde, 27 mai 2022.
[25] Mohammed Hardan, Dan Wilkowsky, Amberin Zaman, “Turkish-backed rebels leave trail of abuse and criminality in Syria’s Afrin”, Al-Monitor, 22 juillet 2021. https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/turkish-backed-rebels-leave-trail-abuse-and-criminality-syrias-afrin
[26] Lauren Wolfe, “There are no real ‘safe zones’ and there never have been”, Foreign Policy, 30 mars 2017. https://foreignpolicy.com/2017/03/30/there-are-no-real-safe-zones-and-there-never-have-been-syria-iraq-bosnia-rwanda/
[27] Elizabeth Hagedorn, “‘Nobody cares about us’: Syrians stuck at Rukban camp decry lack of testing”, Al-Monitor, 16 avril 2020. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/syria-camp-rukban-lacktesting-coronavirus-covid19.html
[28] Jérôme Drevon, Patrick Haenni, How Global Jihad Relocalises and Where it leads. The case of HTS, the former AQ Franchise in Syria, EUI Working Papers, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence, août 2021.
[29] Patrick Haenni, Arthur Quesnay, “Survivre à la disparition de l’Etat islamique. La stratégie de résilience du mouvement kurde syrien”, Research Project Report, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence, janvier 2020.
[30] Pinar Dinc, “The Kurdish Movement and the Democratic Federation of Norther Syria: An Alternative to the (Nation-)State Model?”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol.22, No 1, 2020, pp. 47-67.
[31] Haenni & Quesnay, op.cit., p.7
[32] Shelly Kittleson, « Syrian prison battle leaves hundreds dead and many IS free », Al-Monitor, 26 janvier 2022. https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/syrian-prison-battle-leaves-hundreds-dead-and-many-free
[33] Daniel Meier, « Le Kurdistan d’Irak : les disputed territories comme enjeu de définition nationale », Orients Stratégiques, N° 2, 2015, pp. 93-111.
[34] Ce processus a été théorisé comme étant un des scénariii de la fragmentation politique dans les zones interstitielles. Cf. Daniel Meier, “ ‘Disputed territories’ in northern Iraq: The frontiering of in-between spaces”, Mediterranean Politics, Vol. 25, No 3, 2019, pp. 351-371.
[35] Dan Wilkowsky, Amberin Zaman, “Syrian Kurdish unity talks crumble as Turkey escalates anti-PKK campaign”, Al-Monitor, 12 mai 2022.
[36] Soulayma Mardam-Bey, « L’opération militaire turque souligne la faiblesse de Bagdad et d’Erbil », L’Orient-le Jour, 29 avril 2022.
[37] Raffaella Del Sarto, Malmvig Helle, Soler i Lecha Eduard, Interregnum: the regional order in the Middle East and North Africa after 2011, MENARA final report, No 1, 2019.
[38] Ruth Hanau Santini, “A New regional Cold war in the Middle East and North Africa: Regional Security Complex Theory”, The International Spectator, Vol. 52, No 4, 2017, pp. 93-111.
[39] Thanassis Cambanis & alii., Hybrid Actors. Armed Groups and State Fragmentation in the Middle East, New York: The Century Foundation Press, 2019.

